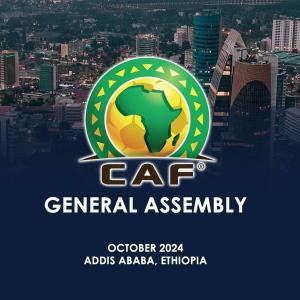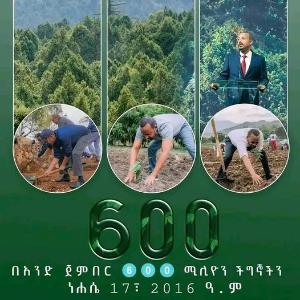Article vedette - ENA Français
Article vedette
Quand le passé réunit avec le renouveau : l’essor touristique de l’Éthiopie et la magie de Noël à Lalibela.
Jan 7, 2026 300
Par un membre de la rédaction Depuis des siècles, l’Éthiopie se distingue par une histoire d’une rare profondeur, une spiritualité profondément enracinée et des traditions culturelles toujours vivantes. Des vestiges de civilisations antiques aux églises monumentales creusées dans la roche, en passant par des rites ancestraux transmis sans rupture, le pays propose une authenticité culturelle que peu de destinations peuvent égaler. Cet héritage exceptionnel a durablement établi l’Éthiopie comme une référence mondiale pour les voyageurs en quête d’histoire, de foi et d’identité culturelle. Ces dernières années, le tourisme s’est affirmé comme un axe stratégique majeur du programme national de développement. Reconnu pour sa capacité à stimuler une croissance durable, à générer des emplois et à renforcer les recettes en devises, le secteur bénéficie désormais d’une attention politique accrue et d’investissements structurés. Cette orientation traduit une volonté claire de transformer le vaste patrimoine naturel et culturel du pays en un levier de développement économique inclusif. Au cœur de cette dynamique figure l’initiative nationale lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, connue sous le nom de « Dine for Nation ». Ce programme ambitieux a favorisé la mobilisation des ressources nationales afin de construire de nouveaux lodges touristiques, de réhabiliter des sites existants et de valoriser des destinations jusque-là peu exploitées. Au-delà des infrastructures, l’initiative a contribué à renforcer le sentiment d’appropriation collective et la fierté nationale autour du potentiel touristique de l’Éthiopie. Grâce à ces efforts, le pays enregistre une progression régulière du nombre de visiteurs, tant nationaux qu’internationaux. De nouvelles destinations viennent compléter les sites historiques emblématiques, offrant une expérience touristique plus riche et diversifiée. En conciliant héritage millénaire et modernisation du secteur, l’Éthiopie consolide sa place sur la scène touristique mondiale tout en faisant de son patrimoine un vecteur d’unité et de prospérité durable. Au centre de cet engouement croissant se trouve Lalibela, ville ancestrale mondialement connue pour ses églises monolithiques et haut lieu spirituel de Genna, la Noël orthodoxe éthiopienne. La cité s’apprête à accueillir, ce mercredi 7 janvier 2026, d’importantes célébrations marquant la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens orthodoxes du pays. Chaque année, Lalibela devient l’épicentre des festivités de Noël en Éthiopie, attirant des centaines de milliers de pèlerins, de religieux et de visiteurs venus de toutes les régions du pays et de l’étranger. Surnommée la « Jérusalem de l’Afrique », la ville abrite onze églises spectaculaires taillées dans la roche ainsi que le symbolique fleuve Jourdain, héritage visionnaire du règne du roi Lalibela. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site sacré a su préserver des rituels religieux quasiment inchangés depuis des siècles. Selon l’Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), plus d’un million de visiteurs sont attendus cette année pour les célébrations de Genna. La forte affluence observée à l’approche des festivités confirme le statut de Lalibela comme première destination touristique du pays. Les célébrations de cette année promettent une atmosphère particulièrement intense, rythmée par des offices religieux solennels, des chants liturgiques, des musiques traditionnelles et des expressions culturelles reflétant la richesse spirituelle et sociale de l’Éthiopie. Pèlerins et touristes se rassembleront dans le décor saisissant des paysages montagneux et des sanctuaires de pierre millénaires, donnant naissance à une ambiance unique de ferveur et de fierté culturelle. Dans le nord de l’Éthiopie, Noël dépasse le cadre strictement religieux : il constitue une expérience culturelle totale, où foi, histoire et cohésion communautaire se conjuguent harmonieusement. Cette année, la célébration revêt une signification particulière, coïncidant à la fois avec la naissance de Jésus-Christ et celle de saint Lalibela, renforçant ainsi la portée symbolique de l’événement. En amont des festivités, les autorités locales ont confirmé que les hôtels, les opérateurs touristiques, les services de santé, les forces de sécurité et l’ensemble des prestataires concernés ont finalisé leurs préparatifs afin d’assurer un accueil optimal aux visiteurs. Alors que l’Éthiopie poursuit son ambition de s’imposer comme une destination touristique de premier plan à l’échelle mondiale, la célébration de Noël à Lalibela illustre avec force la manière dont un héritage ancien et une vision moderne peuvent se conjuguer pour séduire et inspirer le monde.
Assurer la stabilité des prix alimentaires face aux incertitudes mondiales : Expériences d’Addis-Abeba
Jan 5, 2026 208
Traduit de l’article de Ledet Muleta Addis-Abeba, le 5 janvier 2026 (ENA) : - Au niveau international, les villes sont de plus en plus confrontées à une augmentation soutenue des prix des denrées alimentaires. Des facteurs tels que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les aléas climatiques, la poussée inflationniste et la montée des tensions géopolitiques alimentent cette tendance. Depuis la pandémie de COVID-19, ces difficultés se sont accentuées, les confinements, les restrictions de transport et le ralentissement économique ayant mis en évidence les fragilités structurelles des systèmes alimentaires mondiaux. Dans ce contexte, garantir un accès abordable aux produits de première nécessité pour les ménages à revenus faibles et intermédiaires s’impose comme un défi politique majeur de notre époque. Face à cette réalité mondiale, l’administration municipale d’Addis-Abeba a mis en place une réponse pragmatique et centrée sur les besoins des citoyens afin de faire face à l’un des enjeux urbains les plus pressants : le renchérissement du coût de l’alimentation. Cette stratégie repose notamment sur la construction et la mise en service de centres de marchés modernes, complétés par des marchés de producteurs organisés le week-end, visant à établir un lien direct entre agriculteurs et consommateurs. L’objectif est de réduire les coûts, d’améliorer la qualité des produits et de renforcer la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Implantés le long des principaux axes d’entrée et de sortie de la capitale, notamment à Lafto Hulegeb, Akaki Kality, Lemi Kura et Kolfe Sub City, ces centres de marché jouent un rôle clé dans la stabilisation des prix des produits de base. Conçus comme des espaces commerciaux structurés, propres et accessibles, ils permettent aux producteurs de commercialiser directement leurs récoltes auprès des habitants de la ville. Pendant de nombreuses années, les prix alimentaires à Addis-Abeba ont été alourdis par des circuits de distribution longs et peu efficaces, caractérisés par la présence de multiples intermédiaires. Chaque maillon supplémentaire augmentait les coûts, réduisait la fraîcheur des produits et limitait la transparence. Les nouveaux centres de marché rompent avec ce modèle traditionnel. En rationalisant la chaîne d’approvisionnement, la ville limite le rôle des intermédiaires, favorise l’arrivée de produits plus frais sur les étals et garantit des prix plus justes et mieux encadrés, notamment pour les céréales. Les consommateurs bénéficient ainsi d’une meilleure traçabilité des produits, tandis que les agriculteurs profitent de revenus plus élevés, d’une demande plus stable et d’une relation directe avec leur clientèle. Pour encourager leur participation, l’administration municipale propose des conditions attractives, notamment des loyers réduits pour les stands et des exonérations fiscales. Les marchés de producteurs organisés le week-end, désormais présents dans l’ensemble des quartiers de la capitale, viennent compléter ces dispositifs. Plus proches des zones résidentielles, ils dynamisent les quartiers et réduisent les coûts liés au transport et à l’exploitation commerciale, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Pris dans leur ensemble, ces efforts dépassent la simple amélioration de l’accès à l’alimentation et contribuent à la stabilisation globale des prix alimentaires à Addis-Abeba. Bien que la ville ne soit pas totalement épargnée par la hausse mondiale des prix, elle fait preuve de résilience en déployant des mesures ciblées et efficaces pour en atténuer les effets. Les ménages à faibles et moyens revenus sont les principaux bénéficiaires de cette approche, car même une réduction modeste des prix alimentaires peut avoir un impact significatif sur leur pouvoir d’achat. À l’échelle urbaine, cette stratégie renforce également la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Afin de maximiser les retombées positives de ces initiatives, la population est encouragée à fréquenter régulièrement les marchés ouverts toute la semaine ainsi que les marchés de producteurs du week-end, permettant ainsi une utilisation optimale des infrastructures mises à disposition.
Quand les visions convergent : les dirigeants éthiopiens et indiens à Addis-Abeba
Dec 16, 2025 628
L'après-midi du 16 décembre 2025 était frais et clair à Addis-Abeba. Lorsque l'avion du Premier ministre indien Narendra Modi a atterri à l'aéroport international de Bole, ce moment était empreint d'une urgence contemporaine mêlée à une familiarité ancestrale. Il ne s'agissait pas d'une simple visite diplomatique, mais d'une rencontre entre deux des dirigeants les plus transformateurs du Sud, réunis à un moment charnière de l'histoire mondiale. Le Premier ministre Abiy Ahmed attendait à l'aéroport, son sourire chaleureux caractéristique reflétant un dirigeant pleinement conscient de l'importance historique du moment. Lorsque les deux dirigeants se sont embrassés, leur geste en disait plus long que les mots. Il s'agissait d'une rencontre entre deux réformateurs apparentés, deux hommes qui avaient profondément remodelé la gouvernance de leurs pays respectifs. Le Premier ministre Modi a transformé la bureaucratie indienne grâce à la numérisation, permettant à des millions de personnes d'accéder aux services bancaires grâce à la technologie. Parallèlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a mené des réformes qui ont ouvert l'une des économies les plus fermées d'Afrique, mettant l'Éthiopie sur la voie ambitieuse de devenir le premier pays à revenu intermédiaire du continent. Ces deux dirigeants sont non seulement des auteurs et des poètes accomplis, mais aussi des praticiens visionnaires de la transformation. L'initiative « Digital India » de Modi a permis de mettre en place une infrastructure numérique desservant plus d'un milliard de personnes, tandis que la philosophie de synergie « Medemer State » d'Abiy a uni une nation et ouvert des opportunités qui étaient restées fermées pendant des décennies. Ces deux dirigeants visionnaires dirigent leurs nations à un moment où les relations historiques entre l'Éthiopie et l'Inde, qui remontent à plus de deux millénaires, se transforment en un partenariat moderne et dynamique alimenté par la croissance du commerce et des investissements. Si leurs liens culturels communs remontent au royaume d'Aksoum, lorsque les marchands indiens faisaient le commerce de textiles, d'épices et d'autres marchandises via le port d'Adulis, les deux pays ont officialisé leurs relations diplomatiques il y a 70 ans, en 1950. À cet égard, la complicité entre les deux dirigeants était évidente dès le début. Alors qu'ils discutaient de la prochaine présidence indienne du BRICS en 2026, avec l'Éthiopie comme nouveau membre du bloc, tous deux pouvaient clairement envisager les possibilités de collaboration et de progrès communs. Avec plus de 6,5 milliards de dollars d'investissements indiens ayant déjà généré 17 000 emplois en Éthiopie, ils ont évoqué la possibilité d'étendre cette réussite. Des diplômés éthiopiens en informatique travaillaient déjà à distance pour des entreprises technologiques indiennes, tandis que des sociétés pharmaceutiques indiennes installaient des unités de production dans des parcs industriels éthiopiens. La visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie apparaît désormais comme un moment charnière dans les relations bilatérales, transformant un partenariat historiquement chaleureux en un alignement politique, économique et sécuritaire plus large, façonné par des priorités stratégiques communes. Il s'agit de son premier voyage officiel en plus de dix ans, qui intervient alors que les deux pays se repositionnent au sein du Sud global et du cadre élargi des BRICS. Les diplomates qualifient cet engagement d'opportun, soulignant la convergence des intérêts en matière d'autonomie stratégique, de gouvernance numérique et de coopération Sud-Sud. Au cœur de la visite figurent les discussions entre le Premier ministre Modi et le Premier ministre Abiy Ahmed, qui devraient porter sur l'expansion du commerce, les flux d'investissement, le transfert de technologies et les échanges entre les peuples. Les responsables indiquent que les discussions porteront également sur les partenariats industriels, les infrastructures publiques numériques, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et le développement des compétences, des secteurs dans lesquels les entreprises indiennes sont déjà très présentes en Éthiopie. Cette visite s'inscrit dans la continuité des relations régulières entre les dirigeants depuis l'entrée en fonction du Premier ministre Abiy. Sa première visite officielle en Inde, du 27 au 29 octobre 2018, a marqué un renouveau définitif des relations entre les deux pays. À l'issue des discussions à New Delhi, le Premier ministre Abiy a salué l'Inde comme « un partenaire de développement fiable ayant des liens historiques profonds avec l'Afrique », les deux parties ayant convenu d'approfondir leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information, des produits pharmaceutiques et du développement du capital humain. Convergence politique Depuis lors, Modi et Abiy se sont rencontrés à plusieurs reprises en marge de grands forums multilatéraux, profitant de ces rencontres pour façonner une convergence plus stratégique. L'une de ces réunions a eu lieu après l'adhésion officielle de l'Éthiopie au BRICS en janvier 2024. Au cours des discussions, Modi a félicité Abiy pour cette adhésion, tandis qu'Abiy a remercié l'Inde pour son soutien et a félicité Modi pour le succès de la mission Chandrayaan, la qualifiant de « moment de fierté et d'inspiration pour l'Éthiopie et les pays du Sud ». Les deux dirigeants se sont rencontrés régulièrement lors de grands sommets internationaux, le plus récemment lors du sommet du G20 à Johannesburg le 22 novembre 2025, où ils ont discuté de l'élargissement de la coopération dans les domaines de la technologie, des compétences et du développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également participé à plusieurs éditions successives des sommets « Voice of the Global South » présidés par l'Inde, reflétant le rôle croissant de l'Éthiopie dans la diplomatie du Sud. L'Éthiopie a occupé une place importante pendant la présidence indienne du G20, qui a abouti à l'adhésion permanente de l'Union africaine. À l'époque, M. Modi avait décrit l'Éthiopie comme « un partenaire clé pour l'Inde en Afrique », soulignant la coopération dans les domaines de la transformation numérique et de l'industrie manufacturière. Les discussions ont porté sur les projets en cours soutenus par l'Inde en Éthiopie et ont mis en évidence une vision commune pour une gouvernance mondiale plus inclusive. Piliers de l'engagement La réforme de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles restent un autre pilier de l'engagement. Du 12 au 18 mai 2025, une délégation éthiopienne de haut niveau composée de présidents régionaux, de vice-présidents et de ministres de haut rang a participé à un programme de renforcement des capacités au Centre national indien pour la bonne gouvernance. Les responsables éthiopiens ont réaffirmé leur intérêt pour la réforme des politiques, la gouvernance numérique et la prestation de services publics axée sur la technologie, en s'inspirant de l'expérience de l'Inde en matière de transformation administrative à grande échelle. Importance multilatérale La visite de Modi à Addis-Abeba revêt également une importance multilatérale plus large. Les deux pays étant désormais membres du BRICS et l'Inde devant présider le bloc en 2026, les diplomates s'attendent à ce que les discussions donnent un nouvel élan à l'engagement plus large entre l'Inde et l'Afrique, notamment à la reprise des discussions sur la tenue du quatrième sommet du Forum Inde-Afrique, longtemps reporté. Cette visite souligne l'importance stratégique croissante de l'Éthiopie dans la politique africaine de l'Inde et le rôle grandissant de l'Inde dans les calculs économiques et sécuritaires de l'Éthiopie. Avec les investissements, l'agriculture, l'exploitation minière, les infrastructures publiques numériques et la cybersécurité à l'ordre du jour, les discussions permettront de déterminer si la bonne volonté politique de longue date peut se traduire par des résultats durables et à long terme. Racines historiques L'Inde et l'Éthiopie renforcent un partenariat qui tire sa force de plus de 2 000 ans de contacts historiques. Les liens historiques remontent à l'empire d'Axoum au Ier siècle après J.-C., lorsque le commerce prospérait grâce à l'ancien port d'Adulis sur la mer Rouge. Les marchands indiens échangeaient de la soie et des épices contre de l'or et de l'ivoire éthiopiens, jetant ainsi les bases de liens commerciaux et culturels durables. Des relations diplomatiques officielles ont été établies peu après l'indépendance de l'Inde. Des relations au niveau des légations ont été établies en 1948, et des relations diplomatiques complètes ont été établies en 1950, Sardar Sant Singh devenant le premier ambassadeur de l'Inde en Éthiopie. La visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie les 16 et 17 décembre 2025 reflète l'élargissement de l'action de l'Inde vers la région africaine. Après Maurice, le Ghana, la Namibie et l'Afrique du Sud, il s'agit de la cinquième visite de M. Modi sur le continent cette année. L'Éthiopie est une puissance économique montante, un partenaire historique et de longue date de l'Inde en matière de développement sur le continent africain, un membre du forum BRICS et un centre diplomatique de la région. La visite du Premier ministre en Éthiopie contribuera à redynamiser le partenariat de l'Inde avec l'Afrique.
Du patrimoine à l’hospitalité renouvelée : les initiatives touristiques d’Éthiopie redessinent le voyage ver la scène internationale.
Dec 15, 2025 428
Ces dernières années, le secteur touristique éthiopien a connu un essor remarquable, porté par d’importants investissements publics et des initiatives innovants visant à positionner le pays au rang de destination mondiale de premier plan. Au cours des six dernières années, le gouvernement a activement mis en valeur de nouvelles destinations touristiques au niveau national, notamment à Addis-Abeba, dans le cadre de l’initiative innovante « Dîner pour la Nation ». » Cette dynamique stratégique constitue un tournant majeur pour la nation d’Afrique de l’Est, en consolidant son positionnement tant dans le tourisme régional que sur la scène internationale. Riche de paysages saisissants, de traditions culturelles profondes et d’un patrimoine historique remarquable, l’Éthiopie associe aujourd’hui cet héritage millénaire au développement d’infrastructures touristiques modernes pour séduire les visiteurs internationaux et soutenir une croissance économique pérenne. Cette initiative a permi l’émergence de nombreuses destinations touristiques de de classe mondiale, ainsi que la création de cabane et de complexes hôteliers modernes répondant aux standards internationaux, sous l’impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed. En valorisant le riche patrimoine culturel et naturel de l’Éthiopie, ces actions ambitionnent de dynamiser l’économie nationale tout en renforçant l’attrait du pays auprès des visiteurs étrangers. Le programme « Diner pour la nation » compte parmi ses réalisations figurent le Resort Halala Kela, le site écotouristique de Wonchi, ainsi que les complexes hôteliers et auberges de Gorgora, pensés pour séduire une clientèle nationale et internationale. Parmi les projets de développement de lodge de l’Elephant Paw, implanté au cœur du parc national de Chebera Churchura, qui offre des expériences écotouristiques singulières valorisant la riche biodiversité de l’Éthiopie. De plus, le village de Beynouna, récemment inauguré, s'impose comme une attraction majeure, générant des revenus pour l'État tout en apportant des retombées économiques significatives aux communautés locales. Ensemble, ces projets transforment le paysage touristique éthiopien, créant un environnement favorable à la croissance du secteur et positionnant le pays comme une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier. Inauguré récemment, le village de Beynouna s’impose comme l’un des nouveaux sites d’attraction du pays, alliant génération de revenus pour l’État et retombées économiques positives pour les populations locales. Ensemble, ces projets redéfinissent le paysage touristique en Éthiopie, favorisent la croissance du secteur et renforcent l’image du pays comme destination incontournable pour les voyageurs internationaux. À l'échelle mondiale, le tourisme devrait générer plus de 16 000 milliards de dollars de recettes et créer environ 450 millions d'emplois au cours de la prochaine décennie. Les initiatives globales de l'Éthiopie, notamment le développement du village de Beynouna et d'autres projets innovants, permettent au pays de tirer parti de ce marché mondial en pleine expansion tout en améliorant l'expérience des visiteurs grâce à des infrastructures d'hébergement modernisées et des services de qualité internationale. Alors que le tourisme mondial devrait produire plus de 16 000 milliards de dollars de recettes et quelque 450 millions d’emplois dans les dix prochaines années, l’Éthiopie se positionne pour capter une part de cette croissance. Des projets tels que le village de Beynouna illustrent cette ambition, en misant sur des infrastructures modernes et des services de qualité internationale pour enrichir l’expérience touristique. Grâce à la richesse de son patrimoine historique, la diversité de ses paysages et la profondeur de sa culture, l’Éthiopie s’impose progressivement comme l’une des principales destinations touristiques d'Afrique. Grâce à un leadership visionnaire et des investissements stratégiques, le pays se positionne pour séduire les voyageurs internationaux et promouvoir son héritage exceptionnel à l’échelle mondiale. Explorez les destinations touristiques inédites de l’Éthiopie et expérimentez une nouvelle vision du voyage au sein d’un pays dynamique.
La quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer Rouge, une nécessité existentielle générant des retombées positives au niveau régional.
Nov 10, 2025 1161
Traduit de l'article anglais de Yordanos D. Deuxième pays le plus peuplé d’Afrique et doté d’une économie en croissance rapide, l’Éthiopie se trouve aujourd’hui face à un enjeu stratégique majeur : l’accès à la mer Rouge. Cette question ne se limite pas à une revendication politique ou symbolique. Il s’agit, pour le pays, d’une nécessité existentielle, profondément liée à sa trajectoire économique, à sa sécurité, à la coopération régionale et à la stabilité durable de la Corne de l’Afrique. L’accès à la mer Rouge est ainsi bien plus qu’un simple droit : c’est un facteur déterminant de développement et de survie nationale. Historiquement, l’Éthiopie a toujours été connectée à la mer Rouge à travers ses ports de Massawa et d’Assab, qui ont pendant des siècles servi de portes d’entrée vitales pour le commerce international et les échanges économiques. Ces ports ont permis au pays de s’intégrer pleinement aux routes commerciales mondiales, de renforcer son influence régionale et de soutenir la prospérité de ses populations. Cependant, la sécession de l’Érythrée en 1993 a profondément changé cette dynamique. Pour la première fois de son histoire, l’Éthiopie s’est retrouvée enclavée, privée d’un accès direct à la mer. Une situation qui, au-delà des enjeux pratiques, a constitué un véritable bouleversement stratégique et économique. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, « une population de plus de 120 millions d’habitants ne peut rester enclavée. La génération actuelle ne doit pas léguer à la postérité une nation isolée géographiquement. » Cette déclaration illustre la gravité de la question : l’accès à la mer Rouge n’est pas un luxe, mais un impératif national, une condition préalable à la réalisation des ambitions économiques et sociales du pays. La perte du port d’Assab, intervenant sans fondement juridique ni approbation populaire, a engendré un fardeau économique considérable. Il ne s’agit pas d’une simple revendication historique, mais d’une demande légitime, fondée sur des droits historiques, géographiques, économiques et légaux. Le rôle stratégique de la mer Rouge ne se limite pas à l’Éthiopie. Cette étendue maritime est un axe vital du commerce mondial, traversé par une part importante des échanges pétroliers internationaux et par les flux commerciaux reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Plusieurs puissances mondiales y ont implanté des bases militaires, soulignant son importance géopolitique. Dans ce contexte, la situation de l’Éthiopie, située à quelques dizaines de kilomètres de la mer, devient d’autant plus préoccupante : le pays ne peut se permettre de rester isolé de cette voie maritime stratégique. Face à ces défis, l’Éthiopie adopte une approche résolument pacifique et constructive. Le pays cherche à rétablir son accès à la mer Rouge par la négociation et la coopération mutuelle, privilégiant les solutions diplomatiques et juridiques. Cette approche s’inscrit dans une vision régionale plus large, visant à renforcer la stabilité, la paix et la prospérité dans la Corne de l’Afrique. L’accès maritime, loin d’être un enjeu exclusif à l’Éthiopie, représente également une opportunité pour les pays côtiers et pour l’ensemble de la région : il peut favoriser le commerce, stimuler l’investissement et renforcer la collaboration interétatique. Pour l’Éthiopie, la quête de la mer Rouge ne relève pas uniquement de la stratégie économique. Elle s’inscrit dans une démarche de leadership régional, où le pays cherche à promouvoir la coopération, la non-ingérence et le respect mutuel. La stabilité de la Corne de l’Afrique dépend en grande partie de l’intégration et de la coopération entre ses États. Dans ce cadre, l’Éthiopie considère son accès maritime comme un moteur de confiance et de collaboration, capable de générer des retombées positives pour tous les acteurs régionaux. Cependant, cette aspiration se heurte à des tensions historiques et géopolitiques persistantes. L’Égypte, en particulier, a souvent cherché à freiner les initiatives éthiopiennes, notamment sur le contrôle des ressources du Nil Bleu, et continue de diffuser des discours qui s’opposent à la souveraineté éthiopienne sur ses droits d’accès à la mer Rouge. L’Érythrée, de son côté, a parfois servi d’instrument à ces manœuvres, en s’alignant sur certaines positions égyptiennes, comme en témoigne son rejet du Grand barrage de la Renaissance. Le barrage est un projet stratégique majeur, symbole de la modernisation et de l’intégration régionale de l’Éthiopie qui représente un instrument d’émancipation économique et énergétique pour le pays et un moteur d’inspiration pour toute l’Afrique. Selon les propres mots d’Isaias Afwerki, président de l’Érythrée, le soutien de l’Égypte à l’indépendance érythréenne n’était pas motivé par le bien-être du peuple érythréen, mais par une stratégie visant à affaiblir l’Éthiopie, acteur clé du bassin supérieur du Nil. Cette dynamique démontre comment certaines alliances extérieures ont historiquement cherché à déstabiliser l’Éthiopie et, par ricochet, toute la région. L’Égypte et l’Érythrée ont d’ailleurs été impliquées dans la prolongation et l’aggravation de conflits dans la Corne de l’Afrique, y compris au Soudan, perturbant durablement la stabilité régionale. Malgré ces obstacles, l’Éthiopie maintient une politique cohérente de dialogue et de coopération. Le pays privilégie une approche gagnant-gagnant avec ses voisins, basée sur la non-ingérence, le respect des souverainetés et le partage équitable des bénéfices économiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que la recherche d’un accès à la mer Rouge se ferait exclusivement par des moyens pacifiques et légaux, soulignant que le développement éthiopien profiterait également aux pays voisins et renforcerait l’intégration régionale. Les efforts de l’Éthiopie se traduisent concrètement par des projets d’infrastructure de grande envergure, conçus pour faciliter la connectivité régionale et stimuler le commerce. Routes, voies ferrées et interconnexions électriques sont autant de vecteurs de développement, démontrant la capacité du pays à transformer un défi géopolitique en opportunité collective. L’accès à la mer Rouge est perçu comme un catalyseur pour l’investissement, le commerce et la coopération économique, susceptible de profiter à l’ensemble de la région. Sur le plan économique, l’enjeu est crucial. Il y a trente ans, l’Éthiopie disposait de deux ports pour une population de 46 millions d’habitants et une économie de 13 milliards de dollars. Aujourd’hui, la population dépasse les 120 millions et l’économie a été multipliée par vingt, ce qui rend l’accès maritime indispensable pour soutenir le commerce, l’industrie et le développement durable. La sécurisation d’un port maritime fiable constitue donc une priorité stratégique, capable de soutenir la croissance démographique et économique du pays tout en consolidant son rôle régional. En conclusion, la quête éthiopienne pour un accès à la mer Rouge dépasse largement la simple dimension territoriale. Elle représente un impératif national, un vecteur de développement et un instrument de stabilité régionale. L’Éthiopie cherche à atteindre cet objectif par la coopération, le dialogue et la négociation pacifique, transformant une nécessité historique en une opportunité contemporaine. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, « l’existence même de l’Éthiopie est liée à la mer Rouge. » Réaliser cette aspiration, dans le respect des droits légitimes et des principes de coopération, constitue un moteur de prospérité collective et un levier pour la paix durable dans la Corne de l’Afrique. En promouvant des solutions mutuellement bénéfiques, l’Éthiopie illustre la manière dont un pays peut, même confronté à des défis géopolitiques complexes, transformer des contraintes historiques en opportunités de développement économique, d’intégration régionale et de stabilité politique. L’accès à la mer Rouge est ainsi non seulement une nécessité vitale pour l’Éthiopie, mais également un catalyseur potentiel de coopération, de prospérité et de paix dans toute la région. À noter : les points de vue présentés dans cet article sont propres à son auteur et ne représentent pas nécessairement la position officielle de l'ENA.
Le Premier ministre Abiy Ahmed pilote d’importantes initiatives nationales et internationales dans des secteurs stratégiques
Nov 3, 2025 881
En octobre 2025, le Premier ministre a pris une série d'engagements nationaux et internationaux axés sur le développement des infrastructures, la transformation rurale, la réforme de la gouvernance et la coopération diplomatique. Voici un bref résumé du mois écoulé : Sur le développement urbain est les incestissements directs étrangers L'un des moments forts du mois a été la pose de la première pierre de l'usine d'engrais à base d'urée, un projet phare développé dans le cadre d'un partenariat entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote. Avec une capacité de production annuelle de trois millions de tonnes, l'usine utilisera le gaz naturel provenant des gisements de Calub, transporté par un pipeline de 108 kilomètres. Ce projet est la pierre angulaire de la stratégie de l'Éthiopie visant à atteindre l'autosuffisance en engrais et à améliorer la productivité agricole. Dans la région somalienne, le Premier ministre a également inauguré la raffinerie de pétrole de Gode, développée par Golden Concord Group Limited (GCL). Conçue pour traiter 3,5 millions de tonnes de pétrole brut et de condensats par an provenant du champ pétrolier de Hilala, cette raffinerie représente une étape importante dans la voie de l'indépendance énergétique de l'Éthiopie. En complément de ces étapes importantes, le Premier ministre a inauguré la première phase du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Ogaden à Calub. Cette installation, d'une capacité de production annuelle de 111 millions de litres et capable de générer 1 000 mégawatts d'énergie, renforce la base industrielle de l'Éthiopie tout en apportant une contribution essentielle à la production d'engrais et à la production d'énergie. Lors de sa visite à Jigjiga, dans la région somalienne, le Premier ministre a pu constater la transformation rapide de la ville depuis sa dernière visite en janvier 2025. Des milliers de nouveaux logements sont en cours de construction et les projets de développement du corridor améliorent visiblement le bien-être urbain. Il a salué le projet « Dine for Generations », en voie d'achèvement dans la région somalienne, qui ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du tourisme et stimule la croissance économique régionale. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de membres du comité exécutif du Parti de la prospérité, a visité le projet de développement du corridor qui s'étend de Sar Bet à German Square, englobant l'usine de confection et la zone de Furi. Couvrant 589 hectares, il s'agit du deuxième plus grand corridor urbain après Kazanchis. Le projet comprend 16,5 kilomètres de routes asphaltées, 33 kilomètres de voies piétonnes, des places, des installations sportives et récréatives, l'aménagement des berges et plus de 1 100 commerces. Cette initiative incarne la vision plus large de l'Éthiopie, qui consiste à créer des villes modernes, agréables à vivre et économiquement dynamiques. Sur la transformation ruruale et la modernisation Agricole Dans le cadre de la promotion du programme de développement rural de son gouvernement, le Premier ministre a présidé la remise de villages ruraux modèles construits grâce au programme volontaire de la saison des pluies dans les zones d'Halaba, Kembatta, Hadiya et Silte. Chaque maison de ces villages du corridor rural est équipée d'énergie solaire, de systèmes de biogaz, d'installations sanitaires et d'abris pour animaux, ce qui améliore considérablement l'hygiène, le confort et la productivité des familles rurales. Ces villages modèles marquent un nouveau chapitre dans la mission de l'Éthiopie visant à améliorer le niveau de vie rural et à promouvoir des moyens de subsistance durables. Le Premier ministre a encouragé les dirigeants régionaux à étendre ces initiatives, en fixant un objectif de 100 nouvelles maisons par zone d'ici l'année prochaine. Lors de sa visite dans la zone d'East Shewa, dans la région d'Oromia, le Premier ministre a également examiné la récolte de blé de la saison des pluies et lancé les activités de production de blé d'été. Il a évalué les progrès réalisés dans les filières de la banane, de la papaye et de la pisciculture, soulignant l'adoption croissante de l'agriculture mécanisée comme un moteur majeur de la productivité et de l'autosuffisance. Il a également inauguré le projet de développement de l'irrigation de la rivière Welmel à Delo-Mena Woreda, dans la zone de Bale. Une fois pleinement opérationnel, le projet permettra d'irriguer 9 687 hectares de terres agricoles, ce qui profitera à 20 000 ménages agricoles et renforcera la résilience à la sécheresse, la souveraineté alimentaire et l'emploi rural. Sur la gouvernance économique et l’examen macro économique Sur le site du projet Koysha, le Premier ministre a convoqué une session d'examen stratégique avec le Conseil des ministres afin d'évaluer les performances macroéconomiques des 100 premiers jours de l'exercice fiscal 2018 en Éthiopie. L'examen a porté sur les réalisations, les défis et les priorités stratégiques, soulignant la résilience économique soutenue de l'Éthiopie dans un contexte d'incertitude mondiale. Le taux de croissance du PIB national s'est établi à 9,2 % pour l'exercice 2017, soulignant le succès des réformes visant à favoriser une croissance inclusive et diversifiée. Sur la modernisation judiciaire grâce à la transformation numérique Fort du succès de la stratégie numérique 2025, le Premier ministre a annoncé la prochaine stratégie numérique 2030, axée sur la promotion de l'automatisation et l'amélioration de la prestation des services publics. Il a félicité la Cour suprême fédérale pour la mise en place d'un système judiciaire intelligent comprenant la transcription automatisée, les audiences virtuelles et un système intégré de gestion des dossiers qui permet aux justiciables de suivre les affaires en ligne. Couvrant à ce jour 24 branches fédérales, cette innovation marque une étape importante vers une justice transparente et accessible dans toute l'Éthiopie. Sur les media, la culture et le tourisme Le Premier ministre Abiy Ahmed a assisté au lancement du média panafricain Pulse of Africa, une plateforme qu'il avait initialement proposée lors de la 35e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine en 2022. Cette initiative vise à amplifier les perspectives africaines, à contrer les représentations négatives du continent et à renforcer l'unité africaine grâce à des récits communs. Dans son allocution, le Premier ministre a souligné que Pulse of Africa marque une étape importante pour permettre aux Africains de raconter leur propre histoire et de façonner leur image à l'échelle mondiale. Accompagné de la Première dame Zinash Tayachew et d’une délégation de haut niveau composée d’anciens et d’actuels dirigeants, le Premier ministre s’est rendu dans la zone de Bale afin d’évaluer les principaux projets de développement qui intègrent la préservation du patrimoine naturel au progrès national. La délégation a visité le parc national des montagnes de Bale, l’une des zones naturelles les plus écologiquement diversifiées et économiquement importantes d’Éthiopie. Le Premier ministre y a observé les projets touristiques en cours, notamment le Dinsho Lodge, presque achevé au cœur du parc, et le Sof Omer Luxury Lodge, situé près de la célèbre grotte de Sof Omer. Ces deux initiatives s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique décennal visant à faire du tourisme un levier majeur de la transformation économique du pays. Le projet de développement de la grotte de Sof Omer complète ces efforts en améliorant l’accès et les infrastructures destinées aux visiteurs autour de l’un des sites naturels les plus emblématiques d’Éthiopie. La délégation a également inspecté le projet de modernisation de la route Robe–Goro–Sof Omer–Ginir Junction, une route à double voie asphaltée comportant cinq ponts, reliant les zones agricoles productives de l’est et du centre du Bale au reste du pays. Cette infrastructure modernisée vise à améliorer la mobilité régionale, renforcer l’intégration économique et faciliter l’accès aux principales destinations touristiques, notamment le parc national des montagnes de Bale et la grotte de Sof Omer. Le Premier ministre a en outre examiné le projet de contrôle des crues de la rivière Weib, conçu pour réguler le débit d’eau à travers le réseau de grottes, assurer leur accessibilité tout au long de l’année et protéger leur écosystème. Il a également observé les efforts de développement touristique dans le cluster d’Harenna, comprenant la construction du Rira Eco Lodge, de nouveaux points de vue panoramiques, de restaurants et d’aires de dégustation de café le long des itinéraires menant à Tulu Dimtu, le plus haut sommet du parc. Ces projets visent à promouvoir un tourisme durable, à créer des emplois locaux et à mettre en valeur la richesse naturelle et culturelle de la région de Bale. La visite s’est achevée à la cascade de Fincha Habera, où la délégation a exploré un paysage exceptionnel abritant le renard roux d’Éthiopie, une faune aviaire diversifiée et des formations géologiques remarquables, telles que les pics rocheux de Rafu. La région, qui a récemment révélé un réseau de grottes nouvellement découvert, accueillera bientôt un site de glamping destiné à promouvoir le tourisme écologique. À l’issue de la visite, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l’Éthiopie est une terre d’abondance et d’opportunités, exhortant les citoyens à préserver et valoriser les richesses naturelles et humaines du pays pour les générations futures. La délégation a collectivement réaffirmé l’importance d’une gestion responsable, de l’unité nationale et d’un développement visionnaire pour bâtir un avenir durable et prospère pour l’Éthiopie. Engagement parlementaire et discours national Dans son récent discours devant le Parlement éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant les progrès substantiels réalisés par le pays en matière de réformes économiques, de diversification et de développement des infrastructures. Il a souligné que la transition de l’Éthiopie d’une économie essentiellement agricole vers une croissance industrielle et tertiaire produit des résultats remarquables, citant notamment l’expansion rapide du secteur agricole, les recettes d’exportation record et l’augmentation des réserves de change. Les investissements majeurs dans les initiatives écologiques, les infrastructures de transport et les projets énergétiques transforment la productivité et renforcent la durabilité, tandis qu’une gestion prudente de la dette et des subventions ciblées ont contribué à stabiliser l’inflation. Le Premier ministre a également insisté sur l’importance accordée par le gouvernement au renforcement des capacités institutionnelles, à l’accélération de la numérisation, à la formation de millions de jeunes au codage et à la modernisation de la prestation des services publics grâce à la mise en place de centres à guichet unique à travers le pays. Sur le plan de la paix et de la gouvernance, Abiy Ahmed a réaffirmé l’engagement de l’Éthiopie en faveur de la stabilité, du dialogue et de l’unité nationale, tout en mettant en garde contre les acteurs internes et externes cherchant à déstabiliser le pays. Il a insisté sur le fait que la seule voie viable pour l’Éthiopie réside dans une transition politique pacifique et la consolidation de la démocratie. En vue des prochaines élections nationales, il a assuré au Parlement que le gouvernement était prêt à garantir un processus électoral équitable et inclusif. Abordant les relations extérieures, le Premier ministre a réaffirmé le droit de l’Éthiopie à une utilisation équitable des eaux du Nil et a appelé à une coopération accrue avec les pays voisins. Concernant la mer Rouge, il l’a qualifiée de préoccupation historique et économique légitime que l’Éthiopie entend résoudre par le dialogue et le développement mutuellement bénéfique, soulignant que la croissance du pays est étroitement liée à la paix et à la prospérité régionales. Sur les engagements diplomatiques et la coopération régionale Sur la scène internationale, le Premier ministre Abiy Ahmed a conduit la délégation éthiopienne au 24ᵉ sommet de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement du COMESA, tenu à Nairobi (Kenya) sous le thème : « Tirer parti de la numérisation pour approfondir les chaînes de valeur régionales en faveur d’une croissance durable et inclusive. » Dans son discours au sommet, le Premier ministre a souligné que la transformation numérique de l’Afrique représente une opportunité historique de réécrire son récit économique et de renforcer l’intégration continentale. Il a réaffirmé la volonté de l’Éthiopie de travailler en partenariat avec les autres pays de la région afin de promouvoir un avenir numérique commun et inclusif. En marge du sommet, Abiy Ahmed a tenu plusieurs rencontres diplomatiques bilatérales, notamment avec le président Hassan Sheikh Mohamud de la République fédérale de Somalie, pour discuter de questions bilatérales et régionales d’intérêt commun, ainsi qu’avec le Dr Constantinos Kombos, ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, dans le but de renforcer la coopération politique et économique entre leurs deux nations. Reconnaissance des contribuables et réforme de la gouvernance Lors de la 7ᵉ cérémonie annuelle de reconnaissance des contribuables loyaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux contribuables exemplaires pour leur rôle déterminant dans le développement de l’Éthiopie. Il a rappelé que les recettes fiscales sont investies dans les biens publics et les projets d’infrastructure essentiels, tout en exhortant l’ensemble des citoyens à promouvoir la transparence et à rejeter la corruption. Le Premier ministre a souligné que l’intégrité collective et la responsabilité partagée constituent des piliers fondamentaux pour bâtir une nation juste et prospère. Tout au long du mois d’octobre 2025, le leadership décisif et les initiatives visionnaires du Premier ministre dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la rénovation urbaine, de la justice et de la diplomatie ont illustré l’engagement constant de l’Éthiopie en faveur d’un développement inclusif et d’un progrès national durable.
Du constat à l’action : l’Afrique se positionne comme acteur clé dans la lutte contre le changement climatique.
Sep 29, 2025 1711
Traduit de l’article anglais de Mahder Nesibu Addis-Abeba, le 29 septembre 2025 (ENA) : - Le deuxième Sommet africain sur le climat, organisé à Addis-Abeba du 8 au 10 septembre 2025, a marqué une étape charnière dans la réponse du continent face au défi climatique. Longtemps perçue comme une région vulnérable, marginalisée dans les négociations internationales, l’Afrique s’affirme désormais comme une force de proposition, mobilisant des solutions concrètes, des mécanismes financiers novateurs et un leadership politique affirmé. Placée sous le thème « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financement pour un développement durable et vert en Afrique », la rencontre avait pour ambition de transformer l’image de l’Afrique : d’un continent dépendant des engagements internationaux à un acteur maître de son avenir climatique. Avec la Déclaration d’Addis-Abeba, l’Appel à l’action, ainsi que le lancement du Pacte africain d’innovation climatique (ACIC) et du Fonds africain pour le climat (FAC), sous l’impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, le sommet a conjugué vision politique, ambition opérationnelle et stratégie de financement. Ces initiatives placent l’Afrique en position d’influence renforcée dans les grandes négociations climatiques mondiales, notamment à la COP30 de Belém, au Brésil. Le message central était clair : les défis climatiques du continent exigent des réponses unifiées. Jusqu’ici, la diversité des positions nationales et les inégalités institutionnelles avaient fragilisé son poids politique et limité son accès aux ressources financières. Le sommet a répondu à ce défi en forgeant un consensus, matérialisé par la Déclaration d’Addis-Abeba, qui met en avant trois priorités : financer l’adaptation et la résilience, promouvoir les énergies renouvelables et l’industrialisation verte comme leviers de croissance, et développer des mécanismes africains de mise en œuvre et de financement. L’ACIC en est le bras opérationnel : il vise à recenser, développer et diffuser des solutions africaines dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau, des transports et de la résilience urbaine, avec un objectif de 1 000 initiatives financées d’ici 2030. Complémentaire, le FAC ambitionne de mobiliser 50 milliards de dollars par an, en combinant capitaux publics, privés et multilatéraux, pour faire passer les innovations locales du stade expérimental à l’échelle continentale. Ce modèle « solutions plus financement » constitue une réponse directe au paradoxe africain : disposer d’idées innovantes sans les moyens financiers pour les généraliser. Au-delà de leur dimension financière et technologique, ces instruments démontrent la capacité du continent à agir collectivement. Ils valorisent la recherche locale, les savoirs endogènes et la mobilisation de la diaspora, tout en offrant des garanties de transparence et de gestion des risques aux investisseurs. Cette approche consolide la crédibilité internationale de l’Afrique, qui se positionne désormais non plus comme un bénéficiaire passif, mais comme un partenaire stratégique dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Le sommet a également ouvert la voie à des avancées déterminantes dans le domaine du financement, en consolidant l’autonomie d’action du continent. La mise en place d’un cadre de coopération entre les institutions financières de développement africaines et les banques commerciales, visant à mobiliser 100 milliards de dollars, traduit la volonté de l’Afrique de générer des ressources pour la transition énergétique et les infrastructures durables. À cela s’ajoutent des annonces fortes, telles que l’engagement de la Banque européenne d’investissement (100 milliards d’euros d’ici 2027) et les promesses bilatérales du Danemark et de l’Italie, qui confirment la capacité du continent à articuler financements nationaux et internationaux pour concrétiser ses priorités climatiques. Ces appuis complémentaires sont indispensables pour transformer les projets pilotes en investissements privés à grande échelle. Au-delà des aspects financiers, la rencontre a insisté sur la cohérence des initiatives. Elle a validé la deuxième phase du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (AAAP 2.0), qui prévoit de mobiliser 50 milliards de dollars d’ici 2030 afin de renforcer la résilience des systèmes alimentaires, des infrastructures et des zones urbaines. D’autres initiatives phares, comme Mission 300 (qui ambitionne de fournir l’accès à l’énergie à 300 millions de personnes d’ici 2030) et les programmes régionaux de cuisson propre, illustrent la capacité de l’Afrique à concevoir des actions combinant impact social, économique et environnemental. Intégrées dans le cadre de l’ACIC et du FAC, ces initiatives forment un portefeuille cohérent de projets transformateurs, soutenus à la fois par les gouvernements et par les partenaires internationaux. En tant que pays hôte, l’Éthiopie a mis en avant le rôle moteur du leadership national dans la mise en œuvre de solutions concrètes. Elle a présenté des projets phares, comme les campagnes massives de reboisement de l’initiative Héritage vert et les avancées stratégiques autour du Grand barrage de la Renaissance. L’annonce parallèle de la candidature éthiopienne à l’accueil de la COP32 en 2027 souligne une vision plus large : faire de l’Afrique non seulement un espace de débats, mais un véritable architecte de l’agenda climatique mondial. Par cette combinaison d’actions nationales, d’engagement diplomatique et de coordination continentale, l’Éthiopie incarne la manière dont un État africain peut conjuguer réussite domestique et leadership collectif. Au final, l’importance de ce deuxième Sommet africain sur le climat réside dans sa contribution à l’émergence d’une voix africaine unifiée, notamment en amont de la COP30 et des négociations futures. Là où les divergences nationales et les disparités de capacités limitaient jusqu’ici son poids politique, le continent dispose désormais d’une plateforme commune : la Déclaration d’Addis-Abeba, appuyée par des instruments concrets et des engagements financiers tangibles. Cette cohérence donne à l’Afrique une crédibilité accrue, en alignant ses demandes avec les grandes orientations mondiales de financement climatique, telles que la Feuille de route Bakou-Belém de la CCNUCC, qui vise à porter le financement annuel à 1 300 milliards de dollars d’ici 2035. Parallèlement, l’ACS2 a mis en avant le rôle déterminant de la diaspora et des écosystèmes d’innovation dans l’élargissement de l’action climatique africaine. L’ACIC a été conçu pour s’appuyer sur des partenariats avec les universités, les PME et les centres de recherche, tout en mobilisant les réseaux de la diaspora afin de donner une portée internationale aux solutions locales. Cette synergie renforce à la fois les capacités techniques et l’influence narrative du continent : l’Afrique se présente désormais non seulement comme réceptrice de financements, mais comme source de solutions innovantes, viables et reproductibles. En favorisant des plateformes de transfert de connaissances et d’investissements, l’ACS2 illustre un modèle où innovation, finance et unité politique convergent pour soutenir une action climatique continentale. Cependant, les ambitions affichées soulèvent des défis notables. La concrétisation de l’ACIC et du FAC suppose la mise en place rapide de structures de gouvernance solides, la mobilisation de capitaux et l’instauration de mécanismes de suivi transparents. L’objectif de 50 milliards de dollars par an et de 1 000 solutions bancables d’ici 2030 demeure ambitieux et exige l’harmonisation des politiques nationales, des réformes réglementaires et une coopération internationale renforcée. Il est crucial que le financement de l’adaptation repose largement sur des subventions, afin d’éviter d’alourdir la dette des États, tandis que la confiance des investisseurs dépendra de la prévisibilité des cadres politiques, de la transparence et de la clarté réglementaire. Ces risques sont toutefois atténués par le consensus politique et les instruments opérationnels mis en avant lors du sommet. Une lecture comparative permet d’en dégager plusieurs enseignements. L’ACS2 démontre que l’unité politique, la conception technique et la mobilisation financière se renforcent mutuellement. La Déclaration d’Addis-Abeba fixe les priorités et le discours commun de l’Afrique. L’ACIC et le FAC traduisent cette ambition en projets concrets, tandis que les mécanismes financiers continentaux prouvent la capacité de mise en œuvre et la crédibilité du continent. De la même manière que les industries culturelles africaines ont su tirer parti des réseaux diasporiques et des écosystèmes technologiques pour rayonner à l’international, l’ACS2 montre que le leadership climatique africain peut lui aussi être structuré, évolutif et reconnu. Enfin, le sommet a souligné la dimension stratégique et symbolique du leadership africain en matière de climat. En affichant une voix unifiée, des mécanismes opérationnels crédibles et une ambition financière claire, l’ACS2 redéfinit le rôle de l’Afrique : non plus seulement un espace vulnérable en quête de soutien, mais un acteur moteur et partenaire fiable capable de générer des résultats tangibles. Ce changement de paradigme est essentiel : il fait passer le continent d’un récit de fragilité à un récit d’action et de solutions. Si les engagements pris à Addis-Abeba sont mis en œuvre efficacement, l’ACS2 pourrait devenir un moment de bascule, où l’Afrique affirme son leadership climatique en conjuguant ambition, réalisme et influence sur la scène internationale.
Le fleuve Abay n'avait jamais été aussi juste avant l'inauguration du grand barrage.
Sep 10, 2025 1009
Traduit de l’article anglais de Henok Tadele Addis-Abeba, le 10 septembre 2025 (ENA) : - Après quatorze années de labeur acharné et d’un engagement sans faille, le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé aujourd’hui, le 9 septembre 2015 (4 septembre 2025, heure de l’Est), à l’inauguration historique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD). L'événement marque une victoire éclatante pour l’Éthiopie, symbolisant sa persévérance inébranlable et l’ouverture d’un nouveau chapitre empreint de dignité et de souveraineté nationale. Pendant des siècles, l’Éthiopie a été contrainte de regarder le fleuve Abay — bien qu’il fournisse plus de 86 % des eaux du Nil — s’écouler sans que sa source en tire le moindre bénéfice. Des générations entières ont assisté, impuissantes, à ce départ constant de leur ressource vitale vers d’autres terres. Ce fleuve, qui emportait le sol nourricier de l’Éthiopie, devenait paradoxalement une cause d’appauvrissement. Face à cette profonde injustice historique, l’Éthiopie a pris son destin en main. La décision audacieuse de construire un barrage sur le fleuve Abay a été le point de départ d’un projet de souveraineté. Le Premier ministre Meles Zenawi, visionnaire, a posé la première pierre du Grand barrage le 2 avril 2011. Il en revient tout l’honneur. Aujourd’hui, l’inauguration du Grand barrage adresse un message sans équivoque au monde : l’Éthiopie se redresse, forte et indépendante. Le barrage devient non seulement une source majeure d’énergie renouvelable, mais aussi un symbole de coopération régionale et de développement mutuel. Il ouvre la voie à un modèle africain de croissance partagée et de dignité retrouvée. Le GERD a donné naissance à un lac colossal, le lac Nigat (lac de l’Aube), portant en lui l’espoir et la résilience d’un peuple. Ce jour est l’un des plus émouvants de l’histoire nationale — fruit de 14 années de détermination, d’efforts collectifs et de sacrifices immenses. Avec ses 74 milliards de mètres cubes d’eau, le fleuve Abay devient désormais un pilier du développement éthiopien. L’achèvement du Grand barrage éveille chez chaque Éthiopien un mélange profond de fierté, de soulagement et d’émotion. Il mérite d’être honoré. Cette œuvre touche les cœurs, fait couler des larmes, et incarne un rêve transmis de génération en génération. Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est bien plus qu’un ouvrage d’ingénierie : c’est une déclaration d’existence, un acte de justice, un cri de dignité. Il représente ce qu’un peuple uni peut accomplir lorsqu’il refuse de renoncer. Pour l’Éthiopie et pour l’Afrique, il est la preuve tangible qu’aucune vision n’est hors de portée. Quand le monde tourne le dos, l'Éthiopie se dresse fièrement Lorsque l'Éthiopie a enfin osé concrétiser les rêves tant attendus des générations passées et a posé les jalons, le Grand barrage s'est heurté à une résistance farouche, et non à un soutien. Les principales institutions financières internationales ont refusé de financer le projet hydroélectrique, non pas par manque de mérite du barrage ni par manque de vision de l'Éthiopie, mais pour préserver son hégémonie sur les eaux du Nil. Par des voies diplomatiques détournées, l'Éthiopie a été contrainte et soumise à des pressions pour interrompre la construction du barrage, mais en vain. Le peuple et le gouvernement éthiopiens ont poursuivi la construction du barrage hydroélectrique afin de produire de l'électricité pour les communautés rurales, son économie en pleine croissance et l'ensemble de la connectivité électrique régionale. Ce mégaprojet aurait pu être financé par les institutions financières internationales ou cofinancé avec les États riverains, compte tenu de ses implications régionales. Malheureusement, l'Éthiopie a été sommée de rester dans l'ignorance. Face à l'indifférence mondiale, l'Éthiopie a pris la décision audacieuse de financer elle-même le barrage. L'imposition des autres a constitué une ligne rouge pour le peuple et le gouvernement éthiopiens, qui ont patiemment surmonté les obstacles pour achever le barrage avec résilience. Cette injustice centenaire a incité la population et le gouvernement éthiopiens à rassembler une force et une unité inébranlables pour financer le barrage. Partout dans le pays, la population s'est mobilisée pour prendre tout ce qui était nécessaire à l'achèvement de la construction du Grand barrage. Des fonctionnaires ont versé leurs salaires au Grand barrage. Des agriculteurs ont acheté des obligations en vendant leurs récoltes. Des enfants ont déposé des pièces dans des boîtes de dons. Des artistes ont organisé des concerts pour collecter des fonds et motiver l'ensemble de la population à se mobiliser pour le barrage. Les chefs religieux ont prêché l'unité. Les pauvres ont donné ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ce fut un véritable réveil national, un acte collectif de résistance contre l'injustice. Le Grand barrage a une capacité de stockage de 74 milliards de mètres cubes d'eau et une capacité de production d'électricité de plus de 5 150 mégawatts, soit suffisamment pour doubler la consommation d'électricité de l'Éthiopie et alimenter la région en énergie propre et durable. Le Grand barrage : Une victoire collective pour les pays riverains Malgré des années de résistance et de désinformation propagées par les pays en aval, le Grand Barrage de la Renaissance (GERD) représente une source incontestable de bénéfices pour l’ensemble des États du bassin du Nil, y compris le Soudan et l’Égypte. Le barrage permet de réduire les risques d'inondations et de limiter l'accumulation de sédiments dans les régions situées en aval, ce qui contribue à renforcer la productivité agricole. Par ailleurs, sa capacité à piéger les sédiments prolonge la durée de vie des infrastructures hydrauliques en aval. En régulant les crues saisonnières et en assurant un approvisionnement constant en eau pendant les périodes de sécheresse, le Grand barrage apportera une véritable bouffée d’oxygène à l’économie rurale, notamment pour des millions d’agriculteurs soudanais. Installé sur les hauts plateaux éthiopiens, dans une région encaissée, le réservoir du barrage permet également de limiter les pertes par évaporation, à la différence du lac de retenue du barrage d’Assouan en Égypte. Il est regrettable que l’Éthiopie, pourtant source principale des eaux du Nil Bleu (Abaï), ait longtemps été écartée de l’usage équitable de ce fleuve vital. Pendant des décennies, l'Égypte et le Soudan ont exercé un monopole injuste sur les ressources du Nil, empêchant l’Éthiopie de les mobiliser pour son propre développement. Ce déséquilibre historique a nourri la pauvreté, aggravé les sécheresses et maintenu des millions d’Éthiopiens, surtout dans les zones rurales, sans accès à l’énergie. Le Grand barrage a été conçu comme un levier majeur de développement durable. Il produit une énergie hydroélectrique propre destinée à électrifier des millions de foyers éthiopiens, stimuler le développement industriel et renforcer l’intégration énergétique régionale. Grâce à cette nouvelle capacité énergétique, l’Éthiopie pourra non seulement satisfaire ses besoins internes, mais aussi jouer un rôle clé dans l’alimentation électrique de l’Afrique de l’Est, contribuant ainsi à la prospérité et à la stabilité de toute la région. Le fleuve Abay retrouve enfin sa juste vocation. Depuis des générations, les chants et poèmes éthiopiens peignaient Abay comme une force oubliée, puissante mais ignorée. Aujourd’hui, cette image chargée de douleur a laissé place à une nouvelle réalité : celle de la justice. Abay commence désormais à nourrir équitablement tous les États de son bassin, rayonnant sur l’ensemble de la région. Alors que les turbines s’animent et que la lumière jaillit à travers l’Afrique de l’Est, un nouveau rythme s’élève. Le Nil s’est exprimé — et cette fois, sa voix est celle de l’équité.
GERD : symbole de la résilience africaine
Sep 8, 2025 654
Traduit de l’article d’anglais de Desta Kahsay: Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est un témoignage monumental de la puissance de l'autonomie et de l'aspiration collective, offrant un modèle convaincant de développement non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les pays du Sud. Financé entièrement grâce à l'engagement sans faille de ses propres citoyens, ce projet phare a défié les sceptiques et réécrit l'histoire de ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'une nation mobilise ses propres ressources pour une prospérité inclusive. Depuis sa création, le GERD est bien plus qu'un simple barrage hydroélectrique ; il est un cri de ralliement national, un symbole de la détermination sans faille de l'Éthiopie à exploiter ses ressources naturelles au profit de son peuple. Contrairement à de nombreux projets d'infrastructure à grande échelle en Afrique, qui dépendent souvent fortement des prêts et de l'aide étrangers, le modèle de financement du GERD est uniquement national. Ce choix délibéré était une déclaration audacieuse de souveraineté économique et un rejet des cycles de dépendance qui ont souvent entravé le développement du continent. La participation active d'Éthiopiens de tous horizons a été le cœur battant de cette entreprise monumentale. Des agriculteurs des villages reculés aux professionnels des villes animées, en passant par la vaste diaspora éthiopienne répartie à travers le monde, des millions de personnes ont contribué au Grand barrage de la renaissance ethiopienne avec leur argent durement gagné. Cet effort collectif s'est manifesté sous diverses formes : achat d'obligations GERD, contributions financières directes et même dons en nature tels que des maisons et des voitures, tous destinés à la réalisation d'un rêve commun. Ce niveau sans précédent d'appropriation publique a favorisé un profond sentiment de fierté nationale et un engagement sans faille envers la réussite du projet. Il illustre de manière frappante comment une nation, unie par une vision commune, peut libérer un immense potentiel financier à l'intérieur de ses propres frontières. Ce modèle de financement autonome a non seulement permis de réunir les capitaux nécessaires à la construction de l'un des plus grands barrages hydroélectriques du continent, mais il a également instauré une culture plus profonde de l'épargne et de l'investissement parmi la population, jetant ainsi des bases plus solides pour la croissance économique future. De plus, le GERD est un témoignage vivant qui contredit avec force les perceptions erronées de certains qui ont tenté de le dénigrer en le qualifiant d'« éléphant blanc ». Pendant des années, les détracteurs, souvent extérieurs au pays, ont rejeté le projet, le qualifiant d'entreprise irréalisable, de gouffre financier ou de source de conflit avec les pays en aval. Pourtant, à chaque étape franchie, du remplissage initial réussi au début de la production d'électricité, le barrage a incontestablement démystifié ces mythes. Il a démontré la détermination de l'Éthiopie à sortir ses citoyens de la pauvreté, sa capacité à planifier stratégiquement et son engagement en faveur d'une utilisation pacifique et équitable des ressources communes. Le GERD a ouvert une nouvelle ère pour l'Afrique, démontrant sans équivoque que rien n'est impossible lorsqu'il existe une volonté politique, une unité nationale et une foi inébranlable dans les capacités de son propre peuple. Il constitue une source d'inspiration puissante pour les autres nations africaines, qui peuvent ainsi tirer parti de leurs propres ressources, mobiliser leurs populations et mener à bien des projets de développement ambitieux sans succomber aux pressions extérieures ou à l'attrait d'un financement étranger conditionnel. Les enseignements tirés de la construction du GERD, notamment en termes de financement innovant et de large participation publique, offrent des perspectives inestimables pour un continent qui aspire à une véritable émancipation économique. Dans un monde de plus en plus caractérisé par des incertitudes économiques et des changements géopolitiques, le parcours du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, fondé sur le financement national et la participation publique, est un puissant exemple de résilience, d'autodétermination et de prospérité inclusive. Il est une lueur d'espoir, éclairant la voie pour l'Afrique et au-delà vers un avenir où des rêves monumentaux se réalisent grâce à l'action collective et à une croyance inébranlable en ce qu'une nation unie peut accomplir.
Accord Dangote-Éthiopie : une nouvelle renaissance africaine
Sep 3, 2025 884
Traduit de l’article d’anglais de Henok Tadele le 3 septembre,2025 (ENA): Lorsque l'Éthiopie et le Nigeria se sont serré la main à Addis-Abeba cette semaine pour conclure un accord de 2,5 milliards de dollars américains portant sur un complexe d'engrais, il s'agissait de bien plus qu'une simple transaction commerciale. Il s'agissait d'une déclaration d'intention, d'une affirmation audacieuse selon laquelle l'Afrique est prête à réécrire son avenir agricole grâce à des solutions locales et à une coopération intra-continentale à une échelle sans précédent. Cet investissement historique, mené par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, et le gouvernement éthiopien réformateur du Premier ministre Abiy Ahmed, positionne l'Éthiopie non seulement comme un consommateur d'intrants agricoles, mais aussi comme le premier producteur d'engrais d'Afrique subsaharienne. Avec une capacité prévue de trois millions de tonnes d'urée par an, le projet est destiné à rivaliser avec le complexe d'engrais du Nigeria, qui est déjà la deuxième plus grande usine d'urée au monde. « Il s'agit d'un projet gigantesque », a déclaré M. Dangote lors de la cérémonie de signature, ajoutant : « Passer de zéro à trois millions de tonnes en trois ans n'est pas facile. Mais l'Éthiopie dispose des matières premières, du gaz naturel et d'un leadership visionnaire pour y parvenir. Nous ne nous contentons pas de produire des engrais, nous menons une révolution. » Une nouvelle ère de coopération africaine Pendant des décennies, l'avenir économique de l'Afrique a été décrit en termes de ce que les partenaires extérieurs pouvaient faire pour le continent. Cet accord change la donne. Il s'agit d'un partenariat entre le Nigeria et l'Éthiopie, qui unit les deux nations les plus peuplées d'Afrique autour d'une vision commune de la souveraineté alimentaire et de la transformation industrielle. M. Dangote lui-même a clairement souligné l'importance de cet accord. « Les étrangers ne viendront pas développer votre économie. Je ne suis pas un étranger ici, je suis Africain. Le siège de l'Union africaine se trouve à Addis-Abeba, et il est de notre devoir, en tant qu'Africains, de veiller à ce que l'Éthiopie réussisse. » En ancrant le projet dans les champs gaziers de Calub et Hilala, dans la région somalienne de l'Éthiopie, et en le reliant à l'agriculture et à l'industrie, ce partenariat inaugure un nouveau modèle de développement « l'Afrique pour l'Afrique », dans lequel les Africains tirent parti de leurs propres ressources, de leur capital et de leur vision entrepreneuriale pour briser le cycle de la dépendance. Le facteur Dangote Cet accord souligne également le rôle croissant d'Aliko Dangote, qui est bien plus qu'un simple magnat de l'industrie nigériane. Son usine d'engrais à Lagos a déjà transformé l'agriculture nigériane en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations et en stabilisant les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, en s'implantant en Éthiopie, M. Dangote est à la tête d'une révolution continentale dans le domaine des engrais, mais aussi dans celui de l'agriculture. Son ambition va au-delà de la production d'urée. « Nous ne nous arrêterons pas à l'urée », a-t-il promis lors de la signature de l'accord. « Nous produirons toute la gamme des engrais NPK. L'Éthiopie deviendra un exportateur net, et non plus un importateur. » Vision stratégique de l'Éthiopie Pour l'Éthiopie, ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de résilience et de substitution des importations du Premier ministre Abiy Ahmed. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy a souligné à la fois l'urgence et la discipline requises. « Le projet est en bonne voie pour être achevé dans les délais prévus. Nous le superviserons avec la plus grande discipline, car il s'agit d'une entreprise hautement importante et stratégique. D'ici 40 mois, l'Éthiopie aura jeté les bases de sa souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré. Le symbolisme est clair : tout comme le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est devenu un emblème national de l'indépendance énergétique, ce complexe d'engrais est appelé à devenir le fleuron industriel de l'indépendance agricole de l'Éthiopie. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est montré tout aussi catégorique, qualifiant l'accord de « nouvelle renaissance (GERD) pour la nation ». « L'Éthiopie dépense chaque année un milliard de dollars pour importer des engrais. Cette usine mettra fin à cette dépendance, permettra d'économiser des devises étrangères essentielles et fera de l'Éthiopie un pôle régional pour la production d'engrais. Il s'agit d'une étape historique, tout aussi importante que le GERD », a-t-il expliqué avec enthousiasme. En intégrant la production d'engrais aux réserves de gaz naturel du bassin de l'Ogaden, l'Éthiopie choisit de ne pas se contenter d'exporter des matières premières, mais d'ajouter de la valeur sur son territoire. Cette stratégie « Made in Ethiopia » et « Import Substitution », qui a permis d'économiser 4,5 milliards de dollars américains en importations pour la seule année 2024/25, illustre le virage de l'Éthiopie vers l'industrialisation grâce à l'intégration des ressources. De l'autosuffisance en blé à l'indépendance en matière d'engrais La guerre entre la Russie et l'Ukraine a mis en évidence la dépendance de l'Éthiopie vis-à-vis des engrais importés. Alors que les prix mondiaux des engrais ont triplé et que les importations de blé ont stagné, l'économie éthiopienne a souffert d'une pénurie d'engrais, l'intrant le plus important pour la production agricole du pays. Pour un pays où l'agriculture fait vivre la majorité de la population, la crise était plus qu'économique, elle était existentielle. Le pays a donc traversé une période très difficile en raison de la nature géopolitique de la politique mondiale en matière de blé et d'engrais. Pour relever tous ces défis, le gouvernement du Premier ministre Abiy a d'abord réagi en augmentant la production de blé irrigué, transformant l'Éthiopie d'importateur net en exportateur net. Aujourd'hui, grâce à cet accord sur les engrais, l'Éthiopie assure l'autre moitié de l'équation : l'autosuffisance en engrais avec une promesse d'exportation. Il s'agit d'une question de souveraineté, a souligné le Premier ministre Abiy dans son discours après la conclusion de l'accord sur les engrais. « Nous devons construire notre système alimentaire sur des bases solides. » Ce projet garantit que l'Éthiopie ne sera plus vulnérable aux chocs extérieurs liés aux engrais. L'Afrique, une superpuissance Agricole Les implications dépassent le cadre de l'Éthiopie. En unissant leurs forces, le Nigeria et l'Éthiopie signalent l'intention de l'Afrique de rivaliser sur le marché mondial des engrais. Un continent autrefois présenté comme le futur grenier du monde est enfin en train de jeter les bases industrielles nécessaires pour remplir ce rôle. L'accord sur les engrais revêt donc une dimension à la fois économique et géopolitique. Il montre que l'Afrique n'est pas seulement un consommateur dans le système alimentaire mondial, mais aussi un producteur en plein essor, capable de nourrir sa propre population et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. La route devant nous L'accord entre l'Éthiopie et Dangote sur les engrais est un projet qui ne se mesure pas seulement en milliards de dollars américains ou en tonnes d'urée, mais aussi en termes de confiance, de vision et de souveraineté. Il s'agit d'un pari sur la capacité de la coopération africaine, des ressources africaines et du leadership africain à tracer une nouvelle voie pour sortir de la dépendance et de la vulnérabilité. Grâce à l'expérience industrielle de Dangote, à l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la mise en œuvre et au symbolisme de la collaboration entre les deux géants africains, ce projet incarne une nouvelle ère. Le complexe d'engrais de Gode est plus que du béton, de l'acier et des pipelines. C'est un monument à la résilience, construit au lendemain d'une crise mondiale, un modèle d'autonomie, fabriqué à partir des matières premières africaines et un signal au monde entier que l'avenir agricole de l'Afrique ne sera pas défini par l'aide ou les importations, mais par l'ingéniosité africaine.
Dépasser l’État-nation : L’Éthiopie initie une coopération pragmatique
Aug 29, 2025 863
Traduit de l’article anglais de Bereket Sisay Addis-Abeba, le 28 a oût 2025 (ENA) : - La situation politique dans la Corne de l’Afrique est souvent décrite à travers un prisme orientaliste, donnant lieu à une image très sombre de la région. La région y est fréquemment perçue comme un épicentre d’instabilité, où les tensions et les menaces politiques sont constantes. Ce regard, bien que biaisé, n’est pas totalement déconnecté de la réalité : la région est en proie à des crises récurrentes depuis de nombreuses années. Conflits ethniques, insurrections terroristes, désordre institutionnel, actes de piraterie et affrontements entre États y ont laissé une empreinte durable. Par ailleurs, l’ingérence d’acteurs étrangers ne fait qu’aggraver les tensions politiques, contribuant à plonger la Corne de l’Afrique dans un profond désarroi. Historiquement, cette région a souvent servi de terrain de manœuvre pour des puissances extérieures, attirées par sa position géostratégique, ce qui en a fait un véritable carrefour d’enjeux internationaux. Dès lors, elle s’est construite comme un espace multipolaire symétrique, où se croisent intérêts concurrents et alliances opportunistes, souvent au détriment de la stabilité locale. Ces dynamiques conflictuelles ont largement façonné l’état actuel de la région, entachant durablement son image et celle de ses nations. Face à cela, il devient impératif de rompre avec cette trajectoire et de promouvoir une nouvelle approche. Cela suppose toutefois une volonté politique affirmée et le courage d’initier des projets de coopération régionale et internationale, fondés sur des bénéfices réciproques, capables de redéfinir en profondeur la perception de la Corne de l’Afrique. Face à cette configuration géopolitique complexe, l’Éthiopie s’est engagée activement à infléchir le cours des événements et à jouer un rôle moteur dans le développement régional, en assumant pleinement ses responsabilités. Cela fait déjà plusieurs années que le pays a repensé son orientation stratégique, adoptant une démarche collective pour faire face aux grands défis régionaux et construire un avenir plus prometteur. Dans cette optique, l’Éthiopie s’investit sans relâche pour promouvoir l’intérêt commun, avec la volonté ferme de tourner la page des turbulences passées et d’ancrer durablement la paix et le progrès dans la région. Comme l’expose clairement sa politique étrangère, Addis-Abeba place ses voisins immédiats au cœur de ses priorités, consciente de l’interconnexion profonde de leurs trajectoires. L’Éthiopie semble ainsi mettre en pratique l’adage : « nous flottons ensemble ou nous sombrons ensemble », soulignant l’indissociabilité des destins régionaux. Cet engagement n’est pas simplement déclaré ; il s’est concrétisé à travers des initiatives collaboratives, menées dans un esprit de réciprocité et de bénéfice partagé, illustrant la volonté éthiopienne de bâtir une stabilité durable. Ces actions, fondées sur le principe du gagnant-gagnant, visent non seulement à consolider la paix régionale, mais aussi à impulser un développement inclusif à l’échelle du continent. Un exemple concret de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix régionale est son implication active en Somalie. Depuis 2006, elle joue un rôle clé dans les efforts de stabilisation du pays, illustrant ainsi son attachement profond au principe de « non-indifférence » face aux crises affectant ses voisins. En s'engageant militairement et diplomatiquement pour soutenir la paix en Somalie, l’Éthiopie a affirmé sa volonté de répondre aux défis régionaux par la coopération. Bien que la menace du groupe terroriste al-Shabaab ne soit pas totalement éliminée, son influence s’est nettement affaiblie, renforçant ainsi la stabilité dans la Corne de l’Afrique. La résilience actuelle du gouvernement fédéral somalien est en grande partie le fruit de l’appui soutenu de l’Éthiopie, en coordination avec d’autres partenaires régionaux et internationaux. L'Éthiopie conçoit cette collaboration non comme une aide ponctuelle, mais comme une responsabilité partagée, guidée par la conviction que la sécurité de ses voisins est indissociable de la sienne. Cette interdépendance est clairement mise en lumière par les propos du Premier ministre Abiy Ahmed, lors de l'investiture présidentielle somalienne de 2022 à Mogadiscio : « Nous ne considérons pas notre progrès en tant que nation comme distinct de celui de nos voisins, car nous comprenons parfaitement qu’un voisin en paix avec lui-même est un allié sur la voie de la prospérité. » Ce message souligne l’approche solidaire et proactive adoptée par l’Éthiopie dans la construction d’une paix durable dans la région. L’Éthiopie a également joué un rôle déterminant dans les efforts de pacification au Soudan du Sud, un pays confronté à une guerre civile persistante depuis son accession à l’indépendance. En s’appuyant sur le cadre régional offert par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), elle a dirigé des médiations complexes entre les factions rivales, aboutissant à la signature d’un accord de paix que beaucoup jugeaient hors de portée. Bien que la mise en œuvre de cet accord reste semée d'embûches, des progrès notables ont été accomplis, et le pays avance lentement vers une stabilité relative. L’engagement actif de l’Éthiopie dans ce processus lui a valu une reconnaissance régionale et internationale, tant son implication a été cruciale pour soutenir la paix et réaffirmer sa responsabilité dans la promotion de la stabilité au sein de la Corne de l’Afrique. En assumant une part significative du fardeau des crises sociales qui frappent la région, l’Éthiopie s’est affirmée comme un partenaire régional incontournable. En dépit de ses propres défis économiques et de la pression liée à sa population nombreuse, elle joue un rôle central dans la gestion de la crise des réfugiés en Afrique de l’Est. Le pays accueille aujourd’hui plus d’un million de réfugiés, principalement originaires du Soudan et du Soudan du Sud, témoignant ainsi d’une solidarité remarquable. Cet engagement humanitaire illustre la vision éthiopienne d’une réponse régionale concertée aux crises, fondée sur la coopération et le développement partagé. À l’échelle internationale, cette attitude a été saluée comme une alternative à la tendance croissante des politiques migratoires restrictives dans les pays du Nord. Par ailleurs, face à l’urgence climatique qui frappe durement la Corne de l’Afrique – une région particulièrement vulnérable – l’Éthiopie a choisi l’action plutôt que l’inaction. Elle a mis en place l’initiative ambitieuse du « Green Legacy » (Héritage vert), visant à restaurer les écosystèmes par la plantation de milliards d’arbres, avec une forte mobilisation populaire. Cette démarche ne s’arrête pas aux frontières nationales : l’Éthiopie partage activement son expertise et fournit des semences forestières à des pays voisins tels que Djibouti et le Soudan du Sud. En contribuant ainsi à un effort régional coordonné contre les effets du changement climatique, elle pose les bases d’une économie verte plus résiliente à l’échelle de la région. Les projets transfrontaliers menés par l’Éthiopie témoignent de son engagement en faveur d’une prospérité régionale partagée. Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) illustre parfaitement cette vision d’un développement coopératif. Bien qu’il offre des avantages directs à l’Éthiopie – notamment en matière d’électrification – le GERD a été conçu dans une optique régionale, visant également à générer des bénéfices pour les pays en aval, tels que le Soudan et l’Égypte. En permettant une meilleure gestion des crues, une régulation plus efficace du débit du Nil et la fourniture d’une énergie renouvelable, ce projet constitue un levier stratégique pour renforcer la sécurité hydrique et énergétique dans une région chroniquement affectée par les pénuries. La production d’électricité à grande échelle issue du barrage devrait stimuler l’industrialisation et le développement du secteur manufacturier, contribuant à dynamiser les économies nationales et à favoriser l’intégration régionale. Cette dynamique est en parfaite cohérence avec les objectifs de l’Agenda 2063, la feuille de route de l’Union africaine pour le développement durable et l’unité du continent. Le renforcement du tissu industriel générera des opportunités d’emploi dans diverses filières, améliorera les revenus des populations et soutiendra une croissance plus inclusive. Ce type d’initiative s’inscrit ainsi dans une logique de transformation structurelle, au service d’un avenir plus stable et prospère pour l’ensemble de la région. De la même manière, la recherche par l’Éthiopie d’un accès à la mer témoigne de son engagement envers une prospérité partagée et une coopération régionale renforcée. Cette ambition ne relève pas d’un intérêt purement national, mais s’inscrit dans une vision de développement collectif, puisque un accès maritime offrirait des opportunités économiques et commerciales significatives aux pays voisins. L’enclavement historique de l’Éthiopie a freiné son potentiel économique et affaibli sa position stratégique, tout en privant la région des bénéfices qu’un tel accès pourrait générer à plus grande échelle. En obtenant cet accès, l’Éthiopie serait en mesure de stimuler des retombées régionales comparables à celles induites par le Grand Barrage de la Renaissance, renforçant ainsi son rôle dans la promotion d’initiatives de développement axées sur l’intérêt commun et la coopération mutuelle. Par ailleurs, l’Éthiopie a joué un rôle central dans le renforcement de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la consolidant en une organisation multilatérale robuste capable de rallier ses membres autour d’objectifs partagés. Cette avancée marque une nouvelle étape dans les efforts du pays pour encourager la coordination et l’intégration régionales. Ces récits reflètent une vérité essentielle : l'Éthiopie vise la croissance et la prospérité par l’engagement collectif. Pour y parvenir, elle privilégie une démarche collaborative afin de surmonter les défis hérités du passé et de mettre en place des stratégies solides garantissant une paix et un développement durables. Une action collective représente une opportunité nouvelle, nécessitant que chaque pays de la région manifeste la volonté politique indispensable pour concrétiser cette vision géopolitique pragmatique. Par leur coopération, ces nations ont le pouvoir de redéfinir les trajectoires politique et économique de la région. Avancer dans un contexte mondial marqué par le chaos est cependant un défi majeur. Aujourd’hui, la scène géopolitique internationale reste tendue : le conflit entre l’Ukraine et la Russie se poursuit, la crise au Moyen-Orient demeure, et la rivalité sino-américaine s’intensifie. Par ailleurs, plusieurs dynamiques préoccupantes émergent en Afrique et dans la région. Il est donc vital de naviguer prudemment à travers cette instabilité politique et économique globale afin de concevoir des solutions adaptées pour l’Afrique de l’Est, et plus particulièrement pour la Corne de l’Afrique, du moins pour l’heure. Pour que cette région accède à la paix et à la prospérité, la collaboration doit aller bien au-delà des paroles. L’Éthiopie a d’ores et déjà pris des initiatives audacieuses ; la question qui se pose désormais est de savoir si d’autres États suivront cet exemple.
Électrifier le commerce intra-africain pour une libération structurelleier le commerce intra-africain pour une libération structurelle
Aug 19, 2025 917
Un choc tarifaire révélateur Le coup est tombé comme un éclair en plein ciel africain. Le jour même où les peuples célébraient la Libération, les États-Unis, sous l’impulsion de l’administration Trump, imposaient des droits de douane massifs sur plusieurs produits africains. Jusqu’à 50 % sur les textiles du Lesotho, 47 % sur la vanille malgache, 30 % sur les voitures sud-africaines. Derrière ces chiffres, une réalité brutale : des économies africaines jusque-là soutenues par l'AGOA (African Growth and Opportunity Act) sont soudainement coupées de leur principal débouché. Mais derrière ce bouleversement se dessine une leçon essentielle : l’avenir de l’Afrique ne dépend pas des faveurs du Nord. Il repose sur sa capacité à construire un marché intégré, autonome et résilient. Et à ce titre, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) devient plus qu’un projet ; elle est la planche de salut d’une souveraineté structurelle tant attendue. Un système inéquitable Le calcul tarifaire proposé par l’administration Trump – basé sur les déficits commerciaux bilatéraux – frôle l’absurde. Le Lesotho, par exemple, exporte pour 200 millions de dollars de textiles vers les États-Unis, mais n’importe que pour 3 millions. Résultat : 50 % de droits de douane sur ses exportations. Même logique punitive pour le cacao ivoirien ou les produits manufacturés ghanéens. Le système pénalise les produits transformés, pourtant sources de valeur ajoutée, et favorise les exportations de matières premières brutes. Une contradiction criante avec les objectifs initiaux de l’AGOA, qui devait justement encourager l’industrialisation africaine. Et les effets ne s’arrêtent pas aux frontières : lorsque l’Afrique du Sud est visée, c’est toute l’Afrique australe qui en souffre. Les chaînes d’approvisionnement régionales sont brisées, les économies enclavées comme le Botswana en subissent de plein fouet les conséquences. Un multilatéralisme affaibli Face à ces mesures unilatérales, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peine à jouer son rôle de régulateur. Son mécanisme de règlement des différends est en crise, paralysant sa capacité à défendre les pays vulnérables. Pourtant, sa directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, a lancé un appel clair depuis Séville : exclure l’Afrique et les pays les moins avancés de cette logique de réciprocité tarifaire injuste. Car ces mesures compromettent la stabilité financière des pays en développement, et menacent la réalisation des Objectifs de développement durable. Le commerce africain : un potentiel encore sous-exploité Mais au-delà des appels à la modération, l’Afrique détient elle-même les clés de sa transformation. Son marché intérieur, encore largement fragmenté, ne représente que 16 à 20 % de son commerce total. Pourtant, la ZLECA offre une opportunité inédite : un marché de 1,3 milliard d’habitants, pour une valeur estimée à 3 400 milliards de dollars d’ici 2030. La réduction prévue de 90 % des droits de douane intra-africains n’est pas un simple ajustement technique : c’est un levier stratégique pour renforcer les industries locales, stimuler l’investissement, et résister à l’afflux de produits bon marché, notamment venus de Chine, dans un contexte de tensions globales. Le temps de l’unité africaine Les tentatives bilatérales ont montré leurs limites. Le Lesotho n’a obtenu que des concessions partielles. La rencontre entre l’Afrique du Sud et Washington s’est soldée par des déclarations symboliques, sans changement concret. Il est temps de miser sur l’unité continentale. Le président de l’Union africaine, João Lourenço, pourrait initier un nouveau pacte : ouvrir les marchés africains aux entreprises américaines en échange d’un allègement des droits sur les produits transformés africains, notamment dans les secteurs textile et agroalimentaire. Car l’Afrique a des cartes à jouer : elle détient une part essentielle des minéraux critiques, comme le cobalt pour les batteries et le platine pour l’hydrogène, indispensables à la transition énergétique des économies occidentales. Ces ressources ne doivent plus être bradées. Construire l’autonomie par l’intégration La réponse à la fragmentation du commerce mondial, ce n’est pas l’isolement. C’est l’intégration continentale accélérée. Les échanges expérimentaux entre le Kenya, le Ghana, l’Égypte et l’Afrique du Sud doivent devenir la norme. Les usines du Lesotho doivent être soutenues pour produire non plus pour le Wisconsin, mais pour Windhoek, Ouagadougou ou Kigali. Les offres chinoises de libre accès doivent être utilisées de manière stratégique, sans recréer de nouvelles dépendances. Comme le souligne Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECA : « Aucun marché ne survivra seul. Notre population combinée est notre force. »
« Balayer le pas de porte des autres alors que le sien est sale »
Aug 18, 2025 743
Traduit de l'article anglais de Gezmu Edecha « Comment peux-tu dire à ton frère : « Frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil », alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ces célèbres versets de la Bible m'ont traversé l'esprit alors que je regardais le président érythréen Isaias Afewerki tenir sa récente conférence de presse de deux heures. Il se tenait devant les caméras, non pas pour réfléchir à la souffrance de son peuple, ni pour offrir une vision d'avenir, mais pour tenir un discours philosophique sur la politique mondiale. C'était un moment surréaliste, un président pontifiant sur les affaires mondiales alors que son propre pays étouffait sous son règne. Lorsque les journalistes l'ont pressé de questions sur l'Érythrée elle-même, il les a écartés d'un geste de la main en disant « Pas le temps maintenant ». Cette réponse en disait long. Tout au long du règne d'Afeworki, l'Érythrée n'a jamais reflété les opinions de son peuple. « L'Érythrée d'Afeworki » est une terre aux frontières fermées, aux bouches fermées et à l'avenir fermé. En Érythrée, il n'y a pas de constitution. Pas d'élections. Pas de presse libre. Il n'y a pas de responsabilité exécutive. Le pays est pris en otage par un seul homme. Afeworki revendique le droit de critiquer les autres tout en réduisant au silence la dissidence, en écrasant des générations et en construisant une économie esclavagiste de facto grâce à une conscription sans fin. Mais sur quelle base morale se fonde-t-il ? Comment un dirigeant qui a si peu fait pour son propre peuple peut-il juger des gouvernements qui, aussi imparfaits soient-ils, ont déployé des efforts pour améliorer le sort de leur population ? Le fiasco érythréen d'Afeworki Je me souviens des premiers jours de l'indépendance de l'Érythrée, de la fierté et des espoirs qui animaient le peuple. La vision était audacieuse : l'Érythrée devait devenir le « Singapour de l'Afrique », un pays propre, efficace et discipliné qui s'élèverait sur la côte de la mer Rouge comme un modèle de développement postcolonial. Les Érythréens avaient consenti d'énormes sacrifices pour cette indépendance, et le monde les regardait avec admiration. Ce n'était pas un rêve vain. Le peuple érythréen est créatif, résilient et extrêmement travailleur. Il est connu pour sa discipline, son amour du pays et sa volonté de construire. Si seulement son gouvernement avait honoré ces vertus, l'Érythrée aurait pu se hisser au rang des étoiles montantes du continent. Au lieu de cela, ce potentiel a été trahi. Sous la direction d'Isaias, l'Érythrée est devenue un État garnison. Pas au sens figuré, mais littéralement. Les jeunes Érythréens sont enrôlés dans un « service national » sans fin, qui sape la vision, les rêves, la créativité et les aspirations de la jeunesse érythréenne en particulier et de la population en général. Avant l'indépendance, les Érythréens avaient des rêves : liberté, démocratie, développement, dignité, etc. Afeworki a réduit le destin de « son Érythrée » à un fiasco ! Une anecdote d'évasion J'ai rencontré une fois à Addis-Abeba une jeune Érythréenne nommée Selam, qui s'était échappée après avoir passé plusieurs années à Sawa. Son crime ? Être une chrétienne évangélique qui aimait beaucoup prier. Ce choix lui a valu deux mois d'isolement cellulaire et la décision de fuir son pays natal pour le reste de sa vie. « Je n'ai pas quitté l'Érythrée pour l'argent », m'a-t-elle dit. « Je suis partie parce que je voulais être traitée comme un être humain. » Elle a marché pendant des jours dans le désert, a été retenue par des trafiquants au Soudan, puis a finalement atteint l'Éthiopie. Selam n'est qu'une parmi des centaines de milliers de jeunes Érythréens. Chaque année, les étudiants les plus brillants d'Érythrée, qui ont des projets pour leur pays et leur famille, vivent une expérience horrible en entreprenant un périlleux voyage à travers les déserts et les mers. Beaucoup se noient en Méditerranée, périssent dans les prisons libyennes ou disparaissent le long des routes des passeurs. « L'Érythrée d'Afeworki » a conduit les jeunes à finir dans les déserts et les mers ! Sans le régime autoritaire d'Isaias, les jeunes Érythréens ne perdraient pas la vie. Ces esprits ne seraient pas détruits. Pire encore, Afeworki n'a aucune politique claire, ni économique ni politique, pour son peuple ! À l'inverse, l'Éthiopie est en plein essor. De l'autre côté de la frontière, l'Éthiopie offre un tout autre tableau : celui d'un pays en proie à des difficultés, certes, mais aussi en pleine dynamique et en pleine mutation. Alors que l'Érythrée d'Isaias reste paralysée par la peur, l'Éthiopie s'impose comme l'une des économies africaines les plus dynamiques. Du gigantesque barrage GERD à la campagne de reboisement Green Legacy, de son adhésion au BRICS à la libéralisation de ses marchés, l'Éthiopie ne se contente pas d'avancer, elle bondit en avant. Plus de trois millions d'emplois ont été créés en seulement deux ans. L'Éthiopie a construit des routes, des chemins de fer, des parcs industriels et lancé une initiative de transformation numérique visant à fournir des services de manière transparente. Le secteur privé est en pleine croissance, les étudiants universitaires obtiennent leur diplôme et les élections libres, malgré les défis, sont devenues une réalité. Cela ne veut pas dire que l'Éthiopie est parfaite. Mais la différence avec l'Érythrée d'Afeworki est énorme. Alors que les Érythréens fuient pour échapper à la conscription sans fin, les Éthiopiens reviennent de la diaspora pour investir dans des entreprises, enseigner dans les universités ou simplement participer à cet élan. Ne prétendons pas que ce contraste est le fruit du hasard. Ce n'est pas la faute du peuple érythréen si son pays s'est effondré. Addis-Abeba est en plein essor. Ce n'est pas la faute des jeunes Érythréens s'ils sont dispersés dans des camps de réfugiés et des centres de détention en Europe, en Israël et au Soudan. L'Érythrée d'Afeworki, un pays captivé par le règne d'un seul homme, est un fiasco. Alors que l'Éthiopie produit de l'énergie propre, l'Érythrée génère la peur ; l'Éthiopie ouvre ses frontières aux investissements, Afeworki transfère des armes, l'Éthiopie investit dans sa jeunesse, tandis que les jeunes Érythréens continuent de fuir en masse, la plupart d'entre eux se noyant malheureusement dans les mers et les océans. Aujourd'hui, près d'un million d'Érythréens vivent hors de leur pays. Rien qu'en Éthiopie, plus de 700 000 réfugiés érythréens ont trouvé refuge et espoir. Ce n'est pas de la migration. C'est un exode. Mais combien d'Éthiopiens vivent en Érythrée ? Presque aucun ! Afeworki, seul exportateur d'insécurité de la région La tragédie de l'Érythrée sous Afeworki n'est pas seulement un problème national, c'est aussi un problème régional. Depuis trois décennies, Isaias Afewerki est le principal exportateur d'insécurité de la Corne de l'Afrique. De son long conflit avec l'Éthiopie à son antagonisme envers Djibouti, en passant par son ingérence en Somalie et au Soudan et son refus constant de s'engager dans la voie diplomatique, son leadership a déstabilisé toute la région. Imaginez une autre voie : si l'Érythrée était un acteur constructif, elle construirait des corridors commerciaux en mer Rouge, approfondirait ses liens avec l'Éthiopie et créerait des emplois transfrontaliers. Au lieu de cela, la région a dû dépenser son énergie à gérer l'antagonisme et la destruction orchestrés par Afeworki. La voie à suivre Il y a de l'espoir pour le peuple érythréen. La position stratégique de l'Érythrée, sa riche culture et sa population disciplinée offrent encore d'énormes promesses, à condition d'être libérées de l'emprise d'Afeworki. Avec la paix et l'intégration, l'Érythrée pourrait devenir exactement ce dont elle rêvait autrefois : une porte d'entrée vers l'Afrique, un centre logistique, une puissance dynamique de la mer Rouge. La paix avec l'Éthiopie n'est pas une menace, c'est la voie à suivre. Un intérêt commun, une énergie partagée, des ports partagés et une dignité partagée. Si le port d'Assab renaissait en tant que port régional, les jeunes Éthiopiens et Érythréens s'engageraient ensemble dans des start-ups, et si l'Érythrée exportait l'électricité produite par le GERD éthiopien, cela permettrait à l'Éthiopie et à l'Érythrée de prospérer. Tout cela est possible. Mais pas sous le joug d'Afeworki. Le peuple érythréen mérite le respect Le peuple érythréen n'est pas brisé. Il n'est pas silencieux par nature, il a été réduit au silence. Il n'est pas pauvre par destin, il a été appauvri par la politique. Son avenir n'est pas perdu, il attend simplement un leader qui le libérera. Le monde doit cesser de considérer l'Érythrée comme un État défaillant. Ce n'est pas seulement un État défaillant. C'est un État captif, dont le potentiel a été détourné par un homme qui ne gouverne pas dans l'intérêt du progrès, mais dans celui de la répression. Alors que l'Éthiopie se redresse et que la Corne de l'Afrique se transforme, le monde doit écouter non pas la voix d'Afeworki, mais le murmure de millions d'Érythréens comme Selam. C'est ce qui a rendu la dernière conférence de presse d'Isaias Afewerki si tragique et si révélatrice. Pendant deux longues heures, il a donné au monde une leçon de géopolitique, d'histoire et de philosophie. Mais il n'a jamais osé regarder son peuple dans les yeux. Il n'a jamais évoqué, pas même une seule fois, l'exil sans fin des jeunes Érythréens. Il n'a jamais parlé d'espoir, car il n'en a aucun à offrir. Au final, ses paroles sont restées en suspens, détachées, défensives et finalement futiles. Un fiasco total ! Et lorsque les caméras se sont éteintes, l'exode a continué. Remarque : les opinions exprimées dans cet éditorial sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l'ENA.
Dynamiser le commerce intra-africain pour une libération structurelle
Aug 17, 2025 546
Addis Ababa 17 août, 2025(ENA) Le coup de tonnerre des droits de douane imposés par Trump à l'occasion du Jour de la libération a provoqué une tempête dans le paysage économique africain. Avec des taux grimpant à 50 % pour les textiles du Lesotho, 47 % pour la vanille de Madagascar et 30 % pour les automobiles sud-africaines, ces mesures cristallisent la brutalité des nations qui, nourries par l'accès en franchise de droits de l'AGOA, sont désormais confrontées à l'exil commercial de leur plus grand marché nordique. Au cœur de cette turbulence se cache une vérité galvanisante : la survie de l'Afrique ne dépend pas de la clémence occidentale, mais de l'accélération de la renaissance commerciale du continent. La zone de libre-échange continentale africaine (AfFTA) apparaît comme le fer de lance de la souveraineté structurelle. L'architecture tarifaire de Trump, qui base les taux sur les déficits commerciaux bilatéraux divisés par les importations, trahit une illogique grotesque. Le Lesotho est l'un des pays africains les plus durement touchés. Le pays exporte environ 200 millions de dollars américains de textiles vers les États-Unis, tandis qu'il n'importe que 3 millions de dollars américains en retour. Avec l'introduction du nouveau système tarifaire réciproque, le Lesotho est confronté à des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur ses marchandises exportées. Le Ghana et la Côte d'Ivoire rencontrent également des difficultés importantes. Le Ghana est soumis à un droit de douane de 10 %, tandis que la Côte d'Ivoire, reconnue comme une puissance agricole exportant près d'un milliard de dollars de cacao vers les États-Unis, est soumise à un droit de douane de 21 %. Cette cruauté mathématique ignore les raisons pour lesquelles les déficits existent. L'Afrique exporte des minerais bruts exemptés de droits de douane, mais est soumise à des taux punitifs sur les produits à valeur ajoutée tels que les vêtements ou le cacao transformé, précisément les secteurs que l'AGOA cherchait à soutenir. Les États enclavés comme le Botswana dépendent des ports sud-africains. Les droits de douane imposés à l'Afrique du Sud ont donc un effet domino dans la région, fracturant les chaînes d'approvisionnement comme du verre fragile. Ce problème s'est aggravé malgré les négociations actuellement en cours avec l'administration Trump. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), créée pour promouvoir un système commercial mondial fondé sur des règles, semble préoccupée par cette crise. Son mécanisme de règlement des différends, qui est fondamental pour son efficacité, est considérablement affaibli, ce qui entrave sa capacité à lutter contre les disparités commerciales et à protéger les intérêts des pays membres. Cette immobilisation a des conséquences importantes pour l'économie mondiale, pouvant entraîner une intensification des tensions commerciales, des mesures de rétorsion et une détérioration des principes fondamentaux des accords commerciaux internationaux. Cependant, l'organisation est optimiste pour l'Afrique. Lorsque Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, s'est exprimée lors de la séance plénière d'ouverture de la 4e Conférence sur le financement du développement à Séville cette année, elle a fait remarquer que les pays en développement, qui avaient prévu d'augmenter leurs recettes d'exportation pour éviter une baisse de leur balance des paiements, sont désormais confrontés à une perturbation si importante qu'elle contribue à l'instabilité financière. « C'est pourquoi nous avons fait valoir que les pays les moins avancés en tant que groupe, et l'Afrique en tant que région, devraient être exemptés de ces droits de douane réciproques, afin que nous puissions mieux les intégrer dans le système commercial mondial, et non les exclure davantage, afin qu'ils aient de meilleures chances d'obtenir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. » L'appel lancé par le directeur général de l'OMC est important, car il pourrait aider les pays du continent à négocier selon le principe de réciprocité, fondé sur les intérêts nationaux de chaque pays. Cependant, les Africains disposent d'une multitude d'opportunités à l'intérieur de leurs propres frontières. Ces opportunités pourraient potentiellement hisser le continent à une position de premier plan sur la scène politique et économique mondiale, lui conférant ainsi un levier considérable. Il est essentiel que les pays africains s'engagent dans des échanges commerciaux entre eux afin d'atténuer la menace imminente de la guerre commerciale mondiale actuelle. Tout en appelant Washington à envisager des exemptions pour les pays les plus pauvres, Mme Okonjo-Iweala a déclaré que le continent ne devait pas attendre la clémence extérieure. Elle a déclaré que le message était simplement que l'Afrique devait devenir plus autonome. Pour y parvenir, elle a souligné la nécessité urgente de mobiliser les ressources nationales, de rationaliser les obstacles réglementaires et, surtout, d'approfondir le commerce intra-africain, qui ne représente actuellement que 16 à 20 % du commerce du continent. Voici la solution. La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui regroupe 54 pays et plus de 1,3 milliard de personnes, n'est plus un rêve bureaucratique, mais une bouée de sauvetage urgente. La mise en œuvre effective de cet accord devrait renforcer le commerce intra-africain et créer des opportunités pour l'Afrique de s'industrialiser et d'accroître sa compétitivité sur le marché mondial. Alors que le commerce mondial se fragmente, le marché intérieur africain, qui devrait atteindre 3 400 milliards de dollars d'ici 2030, devient le dernier rempart. Ces synergies sont latentes. La réduction de 90 % des droits de douane intra-africains prévue par l'AfCFTA les rend viables et urgentes, car les fabricants chinois, exclus des marchés américains, pourraient inonder l'Afrique de produits bon marché, sapant ainsi les industries naissantes. Les négociations bilatérales ont échoué. Les délégations du Lesotho n'ont obtenu que des réductions tarifaires partielles. La réunion à la Maison Blanche en Afrique du Sud a été symbolique, mais n'a pas apporté de solution. L'unité n'est pas négociable. En tant que président de l'UA, João Lourenço pourrait négocier un accord global accordant aux entreprises américaines un accès en franchise de droits aux marchés de consommation africains en plein essor, en échange d'un allègement tarifaire sur les vêtements et les produits agro-industriels africains. Dans le même temps, les minéraux critiques de l'Afrique représentent 92 % des exportations du Botswana et 81 % de l'influence de la RDC. Les États-Unis ont besoin de cobalt pour les véhicules électriques et de platine pour l'hydrogène, mais l'Afrique n'a pas à les céder à bas prix. Les droits de douane imposés par Trump sont une condamnation cinglante de l'hypocrisie du commerce mondial, mais aussi de la fragmentation historique de l'Afrique. La réponse n'est pas le désespoir, mais la défiance par l'intégration. Il est essentiel d'accélérer la mise en œuvre. Les transactions pilotes entre le Kenya, le Ghana, l'Égypte et l'Afrique du Sud doivent passer de quelques centaines à des millions d'expéditions. Les travailleurs du textile du Lesotho méritent des subventions pour se reconvertir ou pour réorienter les usines vers les marchés régionaux. L'offre chinoise d'accès en franchise de droits à 53 pays africains, à l'exception du Lesotho, doit être mise à profit, mais en évitant soigneusement de tomber dans de nouveaux pièges de dépendance. Comme le déclare Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECA : « Aucun marché ne peut survivre seul. Notre population combinée est notre force ». La tempête tarifaire peut faire rage, mais au sein de celle-ci, l'Afrique plante les graines d'une émancipation économique irréversible. Que les usines tournent à plein régime à Lagos pour les consommateurs d'Addis-Abeba, que les start-ups technologiques congolaises se développent dans les pôles de Johannesburg. Lorsque les barrières commerciales se dressent, les continents qui commercent entre eux prospèrent. Le moment de l'Afrique n'est pas en train d'arriver ; il est déjà là, forgé dans le feu des tarifs douaniers injustes et saisi par une vision continentale.
Briève histoire de l'équipe nationale éthiopienne de football
Oct 21, 2024 4735
L'équipe nationale éthiopienne de football, connue sous le nom de Walia, a une histoire riche qui a commencé avec la création de la Fédération éthiopienne de football en 1943. L'équipe a fait ses matchs internationaux en 1947 et a été membre fondateur de la Confédération africaine de football (CAF), participant à la première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 1957. La plus grande réussite de l'Éthiopie a eu lieu en 1962, lorsque le pays a accueilli la CAN et remporté le tournoi en battant l’Égypte en finale, une victoire qui a marqué l'apogée du football éthiopien et a souligné l'importance de l'équipe en Afrique dans les années 1960. L’équipe Walia a également atteint les demi-finales lors des tournois suivants de 1968 et 1970, renforçant ainsi son statut sur la scène continentale. Les décennies suivantes ont cependant été marquées par l’instabilité politique et les conflits en Éthiopie, qui ont eu de graves répercussions sur les performances de l’équipe nationale et sur le développement général du football dans le pays. L’équipe nationale a eu du mal à se qualifier pour la CAN de 1980 à 2013, avec une remontée en puissance lorsque l’équipe s’est qualifiée pour le tournoi de 2013, même si elle n’a pas dépassé la phase de groupe. Ces dernières années, l’équipe Walia s’est concentré sur la reconstruction par le développement des jeunes talents et l’amélioration du championnat national. L’équipe continue d’évoquer la fierté nationale parmi les supporters éthiopiens, qui la considèrent comme un symbole des défis et des triomphes sociétaux plus larges du pays. L’Éthiopie renforce également son rôle dans la gouvernance du football dans ces jours en accueilliant une réunion de la CAF visant à discuter de l’organisation des tournois et des stratégies de développement du sport à travers l’Afrique. Le pays recherche activement des opportunités d’accueillir de futurs tournois de la CAN, en capitalisant sur son expérience historique de l’événement de 1968, qui pourrait considérablement renforcer le tourisme et la fierté nationale. En marge de la conference de CAN, les participants devraient visiter les principales installations sportives de la capitale, notamment le stade national d’Addis Abeba et le stade Abebe Kila. En outre, le 1er juillet 2024, le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement demandé à accueillir la CAN en 2029. Il a assuré que les infrastructures nécessaires seraient rapidement développées si la candidature de l'Éthiopie est retenue. Lors d'un match amical avec d'anciennes stars du football africain, Abiy a souligné les complexités liées à l'accueil de la CAN et les efforts intensifiés déployés pour atteindre cet objectif. Il a nommé les anciennes stars du football nigérian Daniel Amokachi et Nwankwo Kanu ambassadeurs de la candidature, soulignant leur rôle dans la promotion du potentiel de l'Éthiopie. Les discussions en cours avec le président de la CAF reflètent l’engagement du gouvernement en faveur de la sensibilisation du public et de l’achèvement en temps voulu des travaux préparatoires, tels que les hôtels et les stades. Malgré des performances fluctuantes lors de la CAN, les Walia continuent d’incarner l’héritage footballistique de l’Éthiopie tout en s’efforçant d’améliorer sa compétitivité au niveau continental. Les joueurs éthiopiens font de plus en plus leur marque dans diverses ligues internationales, avec des talents notables tells que Saladin Said, Aklilu Ayele, Abubeker Nasser et Biruk Yilma qui ont réussi dans des clubs à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Le parcours des Walias reflète à la fois les défis et les aspirations du football éthiopien, en mettant l’accent sur le développement, la fierté nationale et les succès futurs dans le sport. Les efforts continus de l’équipe pour s’améliorer et ses ambitions d’accueillir des tournois majeurs laissent un espoir prometteur pour le football éthiopien dans les années à venir. Aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a pris part au match amical de football de la Confédération africaine de football (CAF) au stade d'Addis Abeba. D'anciennes légendes du football africain et l'ancienne équipe nationale éthiopienne de football ont participé à la compétition organisée dans le cadre de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Le Premier ministre Abiy a encouragé le secteur sportif du pays en élargissant les installations vitales aux activités sportives. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la CAF ont visité aujourd'hui le stade Adey Ababa, en voie d'achèvement, à Addis-Abeba. D'anciens footballeurs nigérians connus pour avoir joué en Premier League anglaise et dans divers clubs européens, dont les anciens footballeurs Daniel Amokachi et Nwankwo Kanu, ont été élus ambassadeurs d'Ethiopie et ont commencé à faire des démarches pour que la demande de l'Ethiopie soit acceptée. La 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF devrait se tenir demain à Addis Abeba.
L’Ethiopie a battu le record mondial en plantant 615,7 millions d’arbres en une seule journée.
Aug 23, 2024 3181
Addis Abeba, le 23 aout 2024(ENA) : - L’Ethiopie a depassé son plan en plantant 615, 7 millions d’arbres dans le cadre de plantation de 600 millions d’arbres en une seule journée. Saluant cette réalisation, le premier ministre Abiy Ahmed a apprécié l’unite et la perséverance étonnantes des Ethiopiens dans la réalisation de cette réussite. On a appris que 29, 1 millions de personnes ont participé à la plantation historique d’aujourd’hui. Il a également été indiqué que la plantation a été faite sur 318, 400 hectares de terrain. Le premier ministre a également remercié les responsables, les professionnels et les institutions médiatiques pour leurs efforts inlassables dans ce succès historique.
L'Initiative de l'empreinte verte de l’Ethiopie
Aug 19, 2024 975
L'Initiative de l'Empreinte Verte, lancée par le gouvernement éthiopien sous la direction du premier ministre Abiy Ahmed, est un projet ambitieux visant à lutter contre les changements climatiques et à promouvoir le développement durable par la plantation d'arbres à grande échelle. Le projet a pour objectifs principaux la reforestation massive, la lutte contre le changement climatique, et la restauration des écosystèmes locaux. L’objectif central est de planter jusqu'à 20 milliards d'arbres à travers l'Éthiopie sur plusieurs années. Cette vaste opération de reforestation vise à restaurer les terres dégradées et à augmenter la couverture forestière du pays. En augmentant la surface forestière, l'initiative cherche à séquestrer le dioxyde de carbone (CO2), améliorer la qualité de l'air, et atténuer les effets du changement climatique. De plus, le projet souhaite restaurer les écosystèmes locaux, enrichir la biodiversité, et prévenir l'érosion des sols. Pour mettre en œuvre ce projet, des campagnes de plantation d'arbres sont organisées régulièrement. Ces événements impliquent des millions de personnes, incluant des étudiants, des fonctionnaires et des membres des communautés locales. L'initiative privilégie la plantation de diverses espèces d'arbres, tant indigènes qu'exotiques, adaptées aux différents écosystèmes éthiopiens, comprenant des arbres fruitiers, des arbres à bois, et des espèces favorisant la biodiversité. Les communautés locales sont essentielles dans ce processus, jouant un rôle clé dans la préparation des sols, la plantation, et l'entretien des jeunes arbres, ce qui favorise également la sensibilisation environnementale et la création d'emplois locaux. Un suivi régulier est mis en place pour assurer la survie et la croissance des arbres plantés, avec des activités de maintenance pour garantir la réussite à long terme du projet. L'initiative inclut aussi des programmes éducatifs pour informer le public sur les bénéfices des arbres et des forêts et promouvoir la responsabilité environnementale. En outre, elle bénéficie du soutien de diverses organisations internationales, ONG, et partenaires qui fournissent des ressources, des financements, et une expertise technique. Importance de l’initiative L'impact de l'initiative est significatif sur plusieurs fronts. Environnementalement, l'augmentation de la couverture forestière contribue à réguler le climat local, améliorer la qualité de l'air, restaurer la biodiversité, et prévenir l'érosion des sols. Économiquement, le projet génère des emplois locaux et soutient le développement économique en offrant des ressources en bois durable et des produits forestiers non ligneux. Socialement, il favorise un sentiment de communauté et de responsabilité environnementale, crée des opportunités éducatives, et renforce les liens sociaux à travers des objectifs environnementaux communs. En général, l'Initiative de l'empreinte verte est un effort colossal pour améliorer la durabilité environnementale de l'Éthiopie, renforcer sa résilience face aux défis climatiques, tout en mobilisant la communauté et soutenant le développement local. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment appelé les Éthiopiens à entrer dans l'histoire en plantant 600 millions de semis d'arbres la semaine prochaine et à battre leur propre record de plantation. Le premier ministre a partagé sur les médias sociaux ce qui suit : "Le 23 août 2024, laissons notre héritage en plantant 600 millions de jeunes arbres en une nuit". Le Premier ministre a également exhorté le public à mettre leurs empreintes à travers l'Éthiopie avec un esprit unifié, a-t-il déclaré, ajoutant que "lorsque nous nous réunissons, nous pouvons accomplir plus." Succès du Premier ministre Abiy Ahmed dans la lutte contre le changement climatique Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a connu un succès notable dans la lutte contre le changement climatique grâce à plusieurs initiatives clés. L'une des principales réussites est l'Initiative de l'Empreinte Verte, un projet ambitieux de reforestation visant à planter jusqu'à 20 milliards d'arbres. Ce projet a significativement augmenté la couverture forestière en Éthiopie, contribuant à la restauration des terres dégradées et à la réduction de l'érosion des sols. En augmentant la couverture forestière, l'initiative aide également à séquestrer le dioxyde de carbone (CO2), réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et atténuant les effets du changement climatique. Abiy Ahmed a su mobiliser une grande partie de la population éthiopienne, incluant étudiants, fonctionnaires et membres de la communauté locale, pour participer aux campagnes de plantation, renforçant ainsi la sensibilisation environnementale et le sentiment de responsabilité collective. Le soutien de partenaires internationaux, tels que des ONG et des organisations mondiales, a également été crucial. Ces partenaires ont fourni des ressources, des financements et une expertise technique pour soutenir le projet. Par ailleurs, l'initiative a favorisé la création d'emplois locaux dans les domaines de la plantation et de l'entretien des arbres, soutenant le développement économique des communautés rurales. Des programmes éducatifs ont été établis pour sensibiliser le public aux bénéfices des arbres et des forêts, promouvant une culture de responsabilité environnementale. Les efforts de reforestation ont également contribué à réduire les taux de déforestation et à protéger les écosystèmes locaux.
Mémorial de la victoire d'Adwa Au-delà du monument
Feb 11, 2024 1447
L'inauguration du mémorial de la victoire d'Adwa est plus qu'un simple monument, c'est la célébration d'un héritage qui dépasse les frontières du temps et du lieu pour tous les Noirs du monde. Lors de la bataille d'Adwa, il y a 127 ans, les forces éthiopiennes unies ont marqué l'histoire en triomphant des puissances coloniales italiennes. Le mémorial de la victoire d'Adwa, construit au cœur de la capitale de l'Éthiopie, Addis-Abeba, qui sera inauguré aujourd'hui en présence de hauts fonctionnaires et d'invités, illustre cet événement grandiose et sa signification. Le mémorial de la victoire d'Adwa présente des événements historiques majeurs, des personnalités importantes comme l'empereur Menelik II, l'impératrice Taytu Betul et les généraux qui ont mené la victoire de l'Éthiopie dans la bataille. Il dépeint des questions historiques importantes telles que l'esprit du panafricanisme et la lutte de la communauté noire mondiale pour la liberté, qui ont été déclenchées à la suite de la victoire d'Adwa. Ce mémorial est une représentation vivante d'un moment décisif de l'histoire, incarnant l'esprit durable et la résilience de l'Éthiopie, de l'Afrique et de tous ceux qui ont été confrontés à l'oppression à travers le monde. Il est clair qu'Adwa n'est pas seulement un trésor éthiopien ; c'est un joyau dans la couronne du patrimoine africain et une lueur d'espoir pour tous les peuples opprimés du monde. En effet, les Éthiopiens ne se sont pas contentés de vaincre une puissance coloniale en 1896, ils ont écrit un nouveau chapitre de l'histoire, modifiant fondamentalement la perception des Africains dans le monde. En outre, cette victoire a fait voler en éclats la perception de l'infériorité des Africains qui prévalait à l'époque et a montré au contraire un continent riche en stratégie, en bravoure et en quête inébranlable de liberté. Au fil des ans, les échos de la victoire d'Adwa ont résonné à travers les générations, inspirant d'innombrables Africains à envisager un avenir libéré des chaînes du colonialisme. En outre, elle a été une source de fierté et un cri de ralliement pour le changement, allumant les flammes des mouvements d'indépendance à travers le continent. Adwa, à travers le mémorial inauguré aujourd'hui, reste un témoignage vivant de l'esprit indomptable de l'Afrique, un rappel que l'unité et le courage peuvent renverser les marées de l'oppression. En construisant le mémorial de la victoire d'Adwa, les Éthiopiens ne se contentent pas de préserver un héritage historique, ils ravivent aussi un esprit de changement et d'autonomisation. C'est un appel à se souvenir des luttes et des victoires passées, à y puiser de la force et à poursuivre la lutte pour un monde où chaque personne, quelle que soit sa race ou son origine, peut vivre dans la dignité et avoir des opportunités. En résumé, le mémorial de la victoire d'Adwa est donc plus qu'une simple structure de pierre et de métal ; c'est un symbole d'espoir, un sanctuaire de courage et une école d'inspiration pour les générations à venir.
Le Premier ministre a clairement indiqué que cinq problèmes en Éthiopie doivent être équilibrés.
Jun 14, 2022 18235
Lors de la 13e réunion ordinaire de la chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a répondu aux questions posées par les membres du parlement notant qu'il est important de maintenir l'équilibre de cinq questions. Selon le premier ministre, la démocratie et la paix, les affaires ethniques et nationales, les droits des individus et des groupes, l'histoire d'hier et l'épreuve d'hier ainsi que l'intérêt national et les relations internationales. Selon l'explication donnée sur le maintien de l'équilibre concernant les droits des individus et des groupes, il a indiqué que les noms de groupe ne devraient pas être nommés après avoir commis un crime contre la personne. Le Premier ministre a déclaré que l'équilibre entre l'histoire d'hier et le test d'hier devait être maintenu ; l'intérêt national et les relations internationales doivent être préservés. Voilà le résumé de la réponse et des explications données par le Premier ministre Abiy Ahmed lors de la 13e réunion ordinaire de la 6e chambre des représentants du peuple. En considérant les défis qui se sont produits au cours des 4 derniers mois, il est important d'équilibrer les développements et les pertes qui se sont produits.Au cours des dernières années, malgré les défis du COVID-19, de la guerre et de la sécheresse, de nombreux travaux ont été réalisés.4700 kilomètres de routes ont été construits au cours des 4 dernières années.Après le changement, 116 routes piétonnes de large et 151 kilomètres de route goudronnée ont été construites à Addis-Abeba.504 km de route ont été construits dans la zone East Gojam au cours des 2 dernières années.La télécommunication comptait 38 millions d'utilisateurs auparavant et maintenant elle compte 65, 5 millions de clients.Alors q’on dit qu'il faut en faire plus, il n'est pas nécessaire de nier ce qui a été fait.Malgré la guerre et l'instabilité, il y avait 4 sucreries et maintenant il y en a 9.La raison de la pénurie de sucre pendant la construction de l'usine sucrière est due à la forte demande.La destination de la compagnie aérienne était de 115 et maintenant elle est de 127. Le revenu de la compagnie aérienne était de 3, 3 milliards de dollars avant le changement. Maintenant, après le changement, c'est 4, 8 milliards de dollars.La compagnie aérienne éthiopienne a servi 22 millions de passagers.28% des terres agricoles ont été cultivées en tracteur alors que 45% en grappe.Le blé d'été devrait être de 23-24 millions de quintaux.Le gouvernement a accordé 15 milliards de birr d'aide au développement.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


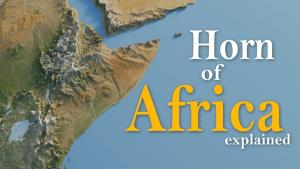
.jpg)
.jpg)
.jpg)